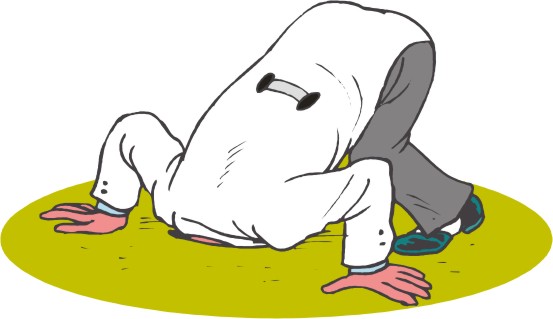Par les temps qui courent, nous n’avons pas besoin de scientifiques cyniques, désespérés, ni même saisis par la culpabilité. Nous avons besoin de scientifiques qui apprennent à rencontrer des interlocuteurs porteurs de questions qui importent, qui leur demandent de poser, avec eux, des questions que leur institution les a incités à ne pas poser. La question de la responsabilité des sciences, toute utopique qu’elle puisse sembler, revêt une pertinence politique cruciale.
* * *

P
LAIDER aujourd’hui pour une recherche scientifique « responsable », ne serait-ce pas céder à la tentation d’une mauvaise utopie ?
Comment éviter de faire ricaner ceux qui dénoncent le rôle des sciences dans ce qu’on appelle le développement ? Et comment intéresser des chercheurs qui se sentent méprisés, harcelés, soumis à une mise en compétition impitoyable et à des mots d’ordre hypocrites ?
Parmi ces mots d’ordre, il y a déjà celui qui évoque une « science responsable » ou, plus précisément, une « innovation responsable » – l’innovation étant désormais ce qui constitue la raison d’être quasi-exclusive de la recherche scientifique.
Selon la prose inimitable de la gouvernance européenne, « l’innovation responsable est un processus transparent et interactif par lequel les acteurs sociaux, les chercheurs et les innovateurs collaborent pour l’acceptabilité éthique, la durabilité et la pertinence sociétale (« societal desirability ») de l’innovation – permettant ainsi l’insertion des avancées des sciences et des techniques dans la société. »[1]− Cité in Rémi Barré, « Des concepts à la pratique de l’innovation responsable : à propos d’un séminaire franco-britannique », Natures Sciences Sociétés, 19, 2011, p. 405-409. /
Comme tous les textes de ce genre, celui-ci est fait pour satisfaire tout le monde. Mais, si on le lit de plus près, il pose bien des questions.
Qui sont d’abord ces « innovateurs », sinon les industries et leurs lobbies. Ceux qui s’y entendent pour faire exister la « désirabilité » de ce qu’ils mettent sur le marché. Ceux pour qui une innovation n’a pas à être durable ou « sociétalement » pertinente : on lui demande seulement d’être profitable pendant le temps de vie d’un brevet, alors que les innovateurs en prépare une autre, qui relancera le marché.
Des acteurs sociaux inattendus se sont invités dans le débat sur les OGM, ont fait bégayer le discours ronronnant des chercheurs et ont restitué à l’affaire sa dimension politique.
La « pertinence sociétale » n’est-elle pas une question politique, impliquant des choix, posant la question : « cui bono ? », sachant que certains « acteurs sociaux » seront plus évidemment intéressés que d’autres.
Mais, c’est surtout le terme « éthique »[2]− NDLR : Lire le texte de Geneviève Azam, Dominique Bourg et Jacques Testart, Subordonner les technosciences à l’éthique, 15 février 2017. / , accolé à « acceptabilité », qui doit attirer l’attention. Il est bien entendu qu’on ne parlera pas ici de politique, au sens de création d’outils et de dispositifs susceptibles de mettre activement en question une innovation, ses conséquences, le type de désirabilité qu’elle suscite, le type d’avenir commun que dessine « son insertion » dans la société.
La question éthique renvoie tout cela aux « valeurs » dans leur sempiternelle tension avec les « avancées » technoscientifiques. Et ces valeurs désignent l’enjeu – pouvons-nous « accepter » ?
L’enjeu, pour nos gouvernants, est que ne se reproduise pas l’affaire des Organismes génétiquement modifiés (OGM) en Europe, le refus obstiné d’« accepter » leur mise en culture, pire la « politisation » de l’affaire. Des « acteurs sociaux » inattendus se sont invités dans le débat, ont fait bégayer le discours ronronnant des chercheurs sur les évidents bénéfices de cette innovation, et ont restitué à l’affaire sa dimension politique : quelle agriculture est en train de s’imposer, et aux détriments de qui et de quoi ? Et le pire est qu’ils ont suscité un écho.
Il était désormais impossible de « gérer » le refus des OGM dans les champs dans le cadre du modèle apolitique dit « du déficit ». Il est difficile d’attribuer à l’ignorance des « gens » ou à leur méconnaissance des exigences de la méthode scientifique ou encore à leur refus (irrationnel) du changement, un processus à la faveur duquel nombre d’entre eux ont appris à se mêler de ce qui n’était pas censé les regarder, et à le faire sur un mode qui, par contraste, a mis en lumière tout ce sur quoi les chercheurs représentant les « avancées » de la technoscience[3]− NDLR : Lire la tribune libre de Joël Decarsin, Impasse de la technoscience, 29 septembre 2015. / faisaient l’impasse.
L’ignorance et la désinvolture arrogante des experts attitrés.
L’expertise collective produite a permis de prendre la mesure du caractère sélectif des savoirs qui permettaient de définir un organisme génétiquement modifié, de découvrir que cette définition dite objective était relative à l’environnement contrôlé et raréfié du laboratoire, et susceptible de perdre sa fiabilité lors d’un passage du laboratoire aux millions d’hectares où les OGM allaient être mis en culture.
Elle a aussi découvert le droit à l’ignorance que réclamaient à cet égard les experts attitrés et la désinvolture arrogante avec laquelle ils minimisaient les conséquences jugées anecdotiques au regard des bénéfices escomptés, qu’il s’agisse de transferts génétiques, d’apparition de lignées prédatrices résistantes ou des conséquences socio-économiques de la mise sous brevet des semences. Sans parler des effets sur la santé des pesticides intensément utilisés.[4]− NDLR : Lire le « Grand Entretien » de Joël Spiroux de Vendômois, « Le XXIème siècle doit devenir le siècle de l’hygiène chimique », 10 juin 2016. /
Le thème de la recherche, ou de l’innovation, « responsable » est une manière de rendormir ce que Walter Lippman a appelé le « public fantôme », celui qui ne s’éveille que lorsque se produit une perte de confiance envers les gouvernants. Il s’agit de l’apaiser, de produire les signaux indiquant que le message a été entendu, afin de restaurer la situation désirable : le public fait confiance, et il se désolidarise des activistes coupables de « politiser » une question d’intérêt commun.
Que « politisation » soit devenu un terme péjoratif, valant accusation, en dit long sur la différence entre gouvernance et démocratie. Pour la plupart des scientifiques, la politisation est synonyme de montée de l’irrationalité.
Pour la plupart des scientifiques, la politisation est synonyme de montée de l’irrationalité.
J’ai souvenir d’un « buzz » qui eut un certain succès parmi eux, lors de la guerre des sciences, la grande offensive médiatisée, dans les années 1990, de scientifiques indignés contre les penseurs critiques[5]− NDLR : Lire la tribune libre de Jacques Testart, Pourquoi et comment être « critique de science » ?, 16 février 2015. / accusés de propager le relativisme, c’est-à-dire l’idée que tout se vaut et que les savoirs scientifiques ne sont que des constructions socio-politiques aux prétentions abusives.
Un comté américain aurait voté pour l’arrondissement à 3,14 du nombre π – tellement plus pratique. Les scientifiques sont usuellement de « bons démocrates », sauf lorsqu’ils croient sentir que la distinction entre « faits » et « valeurs » pourrait être mise en question.
Les « faits » doivent être reconnus comme ce qui a le pouvoir de mettre d’accord, quelle que soit l’opinion. Les « politiser », c’est déclarer la guerre à l’institution scientifique. C’est nier que celle-ci soit un contre-pouvoir planant au-dessus de la mêlée – la référence à la légende dorée du « Et pourtant elle tourne ! » de Galilée, ou à l’aveugle condamnation de la génétique comme « science bourgeoise » par l’État stalinien ressortent ici du réflexe conditionné.
Bien évidemment, lorsqu’il est question de la technoscience d’aujourd’hui, de la recherche mise directement au service de l’innovation et de la compétitivité, la distinction entre faits et valeurs devient une affaire un peu plus compliquée.
Qu’à cela ne tienne : certains « faits » gênants seront alors rejetés comme « idéologiques » et « anti-démocratiques », car s’en servir comme argument, c’est mettre en question l’ordre socio-économique fondé sur la croissance, et s’opposer à la majorité de la population qui « désire » les bienfaits de l’innovation. Et la mise sous brevet ou le secret industriel doivent dès lors être acceptés, voire désirés.
Quant à la rengaine de la « science désormais responsable », pourquoi pas, si c’est une exigence des gouvernants. Mais, à la condition – et ces gouvernants sont bien d’accord là-dessus – que cela ne fasse pas perdre de temps aux chercheurs, que cela ne leur impose pas de s’intéresser à des questions qui ne feraient pas « avancer la connaissance ».
De fait, lorsque l’on pense au régime de travail actuel des chercheurs non-fonctionnaires, à la limitation de leur horizon de recherche à des contrats courts et clairement fléchés, etc., il est clair que l’idée que la survie demande désormais d’être flexible, prêt à tout et n’importe quoi, « motivé » au sens cynique du terme, n’inquiète pas ces gouvernants.
Aujourd’hui, la seule recherche véritablement « responsable », du point de vue de la politique de la recherche, est celle qui renonce à ses rêves d’indépendance et accepte son rôle d’acteur dans la guerre économique.
Aujourd’hui, la seule recherche véritablement « responsable », du point de vue de la politique de la recherche, est celle qui renonce à ses rêves d’indépendance et accepte son rôle d’acteur dans la guerre économique. Les champs de recherche qui ne peuvent contribuer à cette guerre, qui ne sont pas sources d’innovations économiquement prometteuses, vivotent à la marge et/ou sont soumis à l’impératif commun de « répondre à des projets » et de définir leur recherche par les percées (« breakthrough ») prometteuses qu’elle accomplira.
On commence seulement à prendre la mesure des conséquences. Désormais, on parle de cours d’« éthique de la recherche », car ce qui était le type de responsabilité propre au chercheur, en tant que membre de sa communauté, s’évapore à toute vitesse : comment, lorsque la dépendance est entérinée, lorsque les commanditaires sont d’abord intéressés aux promesses d’innovation, éviter que les malversations méthodologiques, la publication de résultats de plus en plus bâclés, voire frauduleux, ne se multiplient ? Comment aussi attendre des scientifiques, qui sont désormais, sauf récalcitrance qu’ils paient cher, « tenus » par les « innovateurs » dont ils dépendent, qu’ils s’engagent dans des recherches dont le résultat pourrait gêner ces derniers.
Seuls les activistes relaient les « faits » qui dérangent – par exemple, dans le cas des OGM, la prolifération de « super mauvaises herbes » issues de transferts génétiques que les experts jugeaient tout à fait improbables.
Comme l’a souligné Francis Chateaureynaud[6]− « L’histoire des OGM n’est pas une controverse ratée mais un conflit réussi », Socio-Informatique et Argumentation, décembre 2010 (Disponible en ligne). / , les controverses, qui faisaient de la fiabilité des faits une valeur collective pour la communauté scientifique concernée, sont affaire du passé lorsqu’il s’agit de faits technoscientifiques, porteurs d’une promesse d’innovation. Ceux-ci sont désormais des objets de conflit, un conflit qui, lorsqu’il « réussit », suscite ce qui devrait être la tâche politique par excellence : clarifier les enjeux et les lignes de clivage.
FAIRE DE LA RESPONSABILITÉ
UNE AFFAIRE POLITIQUE
Comment la question de la responsabilité pourrait-elle, dans ces conditions, devenir une affaire politique ? C’est là un problème sérieux, qui n’a pas de réponse simple.
Seuls les activistes relaient les « faits » qui dérangent.
D’un côté, poser cette question, en faire un thème conflictuel, c’est un peu comme tenter l’assaut d’une position déjà occupée par l’adversaire et, en quelque sorte, déshonorée : seuls les dupes peuvent ignorer qu’il s’agit là d’une cause perdue d’avance. Mais, c’est ici qu’il faut ralentir et se demander ce qui, aujourd’hui, n’est pas cause perdue d’avance.
Si l’agenda de ceux qui tentent de résister au monde comme il va doit répondre aux probabilités de réussite, il risque d’être vide. Et cela signifie aussi que seront toujours plus appauvries les ressources imaginatives sans lesquelles aucun possible ne peut être nourri.
PDF consultable en ligne. Fondation Sciences Citoyennes, « Manifeste pour une recherche scientifique responsable », octobre 2015.
Lorsque l’association Sciences Citoyennes a décidé de diffuser un « Manifeste pour une recherche scientifique responsable », elle l’a fait d’abord parce que l’irresponsabilité, devenue la règle dans nos sociétés, doit pouvoir être mise en cause en tant que telle.
L’irresponsabilité, devenue la règle dans nos sociétés, doit pouvoir être mise en cause en tant que telle.
Les traités et les réformes censés « moderniser » la société font prévaloir le marché, irresponsable par définition, comme seul arbitre légitime là même où chacun sait qu’il accroit les inégalités et détruit la terre. Ainsi de la menace climatique : nos gouvernants affirment que le pire peut être évité, mais il semble que ce soit à la condition qu’il puisse l’être dans le respect de la liberté d’extraction des énergies carbonées et de la libre concurrence non « faussée » par des choix publics favorisant, par exemple, la transition énergétique.
Mais, la question de la responsabilité ne peut se résumer à un refus de l’irresponsabilité. C’est une question qui, si elle n’est pas posée politiquement, mène à l’obscénité de la recherche du bouc émissaire ou à l’hypocrisie de la condamnation du lampiste – par exemple, le chercheur qui, dans un climat de « sauve-qui-peut », de « malheur au vaincu » et de cynisme opportuniste, basculera vers la fraude pure et simple.
Lorsqu’il est question des sciences, la question de la responsabilité confronte, d’autre part, à un problème assez spécifique. Bien des chercheurs seront d’accord pour protester contre l’actuelle politique de la recherche. Mais ils le feront en invoquant un passé où cette dernière était respectée, où les chercheurs étaient évalués par leurs pairs selon le seul critère de leur contribution à l’avancée des connaissances, et où ceux qui bénéficieraient de cette avancée n’avaient pas à interférer dans les choix de recherche, ceux-ci se devant d’être désintéressés.
La question, ici, n’est pas de « déconstruire » cet âge d’or, de souligner que la figure du chercheur indifférent aux « retombées » que son travail a rendues possibles n’a jamais été la norme. Ce serait faire insulte au malaise, à l’amertume, voire à la souffrance et à l’humiliation des chercheurs d’aujourd’hui, qui savent que le sens même de leur métier est nié.
Nous n’avons pas souvenir d’une protestation publique collective à l’encontre d’un collègue prolongeant ses jugements disciplinaires au-delà des lieux où ils sont pertinents.
Mais il s’agit, et c’est le sens même d’une mise en politique du problème de la responsabilité, de donner à ce problème la capacité d’activer la question des rapports entre la recherche et ce public auquel les chercheurs en appellent lorsqu’ils manifestent leur angoisse et leur colère.
En effet, c’est alors à ceux-là même que l’« âge d’or » dont les chercheurs ont la nostalgie a exclus, ou plus précisément inclus en tant que bénéficiaires reconnaissants, qu’ils en appellent. Et cela au moment où nous sommes tous confrontés au caractère désastreux, radicalement insoutenable, d’un « progrès » dont ces sciences de l’âge d’or ont été un moteur.
Les chercheurs rétorqueront qu’ils sont seulement responsables de l’avancée des connaissances, non des conséquences qui lui ont été données. Mais, ce faisant, ils oublient un peu trop facilement que cette non-responsabilité par rapport aux conséquences n’a pas empêché leurs prédécesseurs de l’« âge d’or » d’associer progrès scientifique et progrès social, de faire chorus contre ceux qui voulaient, disaient-ils, nous renvoyer à l’« âge des cavernes », de bénir la séparation générale entre « faits » et « valeurs » et la réduction à de simples valeurs des dimensions d’une situation concrète que leur science ne prenait pas en compte.
On peut, certes, citer des exceptions. Mais justement ce sont des exceptions. Pour le dire poliment, nous n’avons pas souvenir d’une protestation publique collective à l’encontre d’un collègue prolongeant ses jugements disciplinaires au-delà des lieux où ils sont pertinents.
Il est difficile de nier que l’institution qu’on appelle « la science » a participé pleinement à ce que Jean-Baptiste Fressoz a nommé « désinhibition »[7]− Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Seuil, 2013. / , au refus quasi-viscéral, depuis les débuts de la révolution industrielle, de prendre au sérieux les avertissements, mises en garde, critiques de ceux qui, selon le sinistre mot de Pascal Lamy, pensaient qu’on pouvait « arrêter les horloges » – et sur ce point les sciences sociales ont été pleinement actives, préférant analyser le « catastrophisme » plutôt que la manière dont le progrès en est venu à signifier ce qu’il fallait accepter, les yeux grands fermés.
La science a pleinement participé au refus quasi-viscéral, depuis les débuts de la révolution industrielle, de prendre au sérieux les avertissements, les mises en garde et les critiques.
Mettre en politique la question de la responsabilité demande de ne pas entretenir de nostalgie pour « l’âge d’or »[8]− Je me permets de renvoyer à mon livre, dont c’est le thème central : Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, Paris, Les Empêcheurs de penser en … Continue reading , c’est-à-dire pour ce qui était une définition de la science en double jeu. Pile, les scientifiques n’ont pas à se mêler de la manière dont leurs savoirs sont « valorisés » : cela regarde « la société ». Face, ils sont libres de minimiser les objections qui pourraient mettre en cause cette valorisation, sans que leurs collègues ne soumettent leurs arguments au type d’attention qu’ils réservent aux propositions « vraiment scientifiques ».
Quel collègue a jamais demandé à un biologiste défenseur des OGM de présenter ses titres de compétence en ce qui concerne la question de la « faim dans le monde » ?[9]− NDLR : Voir notre dossier : Les OGM peuvent-ils nourrir le monde ?, 23 mai 2015. /
« Nul ne peut s’exonérer de ses responsabilités au nom de son impuissance s’il n’a pas fait l’effort de s’unir à d’autres, ou de son ignorance s’il n’a pas fait l’effort de s’informer. » Cette formule, que le Manifeste de l’association Sciences Citoyennes a empruntée à la Déclaration universelle des responsabilités humaines[10]− Voir le blog de Pierre Calame. / , promue par Pierre Calame, frappe fort et juste lorsqu’il s’agit de la manière dont leur rôle est inculqué aux chercheurs.
Nul ne peut s’exonérer de ses responsabilités au nom de son impuissance s’il n’a pas fait l’effort de s’unir à d’autres, ou de son ignorance s’il n’a pas fait l’effort de s’informer.
S’unir à d’autres et faire l’effort de s’informer à propos de questions qui sont « non-scientifiques », parce qu’elles concernent l’avenir commun, dont ce sur quoi on travaille pourrait être partie prenante, c’est accepter de se laisser intéresser par ces questions. C’est apprendre à écouter ceux qui sont préoccupés par cet avenir. C’est prendre éventuellement le risque de les soutenir contre le jugement sommaire des collègues – et c’est surtout, aux yeux des collègues, perdre un temps qui devrait être tout entier consacré aux questions « vraiment scientifiques », susceptibles de « faire avancer » la connaissance.
Bref, c’est s’exposer à voir se défaire sa cuirasse de certitudes toutes faites quant à la manière dont cette avancée sert la société. C’est entrer en contact rude avec la manière dont les solutions qui semblaient rationnelles peuvent produire des conséquences qu’on n’avait même pas imaginées. Et c’est subir le rejet de son milieu pour qui on a « cessé de faire de la science », voire « on a trahi ». Une petite minorité s’y risquent, mais au prix des pires avanies.
Faire d’une question un enjeu de lutte politique, c’est d’abord dépasser les jugements moraux vers le rapport de force. En l’occurrence, les chercheurs scientifiques peuvent être individuellement capables de bien des choses.
Mais, ils sont d’abord recrutés, formés, évalués par une institution. C’est cette institution qui, depuis qu’elle a défini sa légitimité par l’avancée des connaissances et a lié cette avancée au progrès humain en général, s’est définie « hors politique », hors sol, pourrait-on dire. Car, la mesure de cette avancée, pour être rythmée par « on croyait, maintenant nous savons », se doit de privilégier des questions susceptibles de recevoir une réponse bien définie.
« La » connaissance, si elle doit être caractérisée par une avancée qui vaut pour « tout le monde », doit concerner des situations détachées de mondes particuliers, s’adresser à des situations soigneusement abstraites de milieux qui pourraient rendre indéterminé ou circonstanciel le sens de la réponse obtenue.
Les solutions qui semblaient rationnelles peuvent produire des conséquences qu’on n’avait même pas imaginées.
Les scientifiques savent bien que la « méthode scientifique » n’est féconde que si elle s’adresse à de telles situations. Mais, le discours institué, transmis à l’école, s’adressant au « public », fait comme si cette méthode était tout terrain, permettant une avancée qui, irrésistiblement, remplace l’ignorance par la connaissance.
Et ceux qui s’entêtent à faire importer ce qui a été éliminé pour que passe l’avancée de la connaissance seront accusés de ne rien comprendre à « l’esprit scientifique ».
Activer politiquement la question de la responsabilité, c’est bien sûr activer l’attention sur les technosciences contemporaines et les sciences au service de la gouvernance qui abstraient de manière unilatérale, au nom de la méthode, tout ce qui fait obstacle à la réponse à obtenir − et il y a du pain sur la planche.
Un peu partout, c’est la parabole du réverbère qui domine : l’histoire de celui qui, dans la nuit, cherche ses clefs au pied d’un réverbère parce que c’est le seul endroit où c’est éclairé.
Il importe de ne pas dénoncer l’abstraction scientifique pour elle-même, car ce serait faire le jeu de l’institution, confirmer que ceux qui attaquent « la science » auraient, si l’occasion leur en avait été donnée, attaqué Galilée, Newton ou Pasteur.
La grande réussite de l’affaire des OGM, c’est que le conflit a mis en lumière ce que les promoteurs avaient décidé d’ignorer, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que cela puisse compter.
En revanche, il ne s’agit pas non plus de faire la différence entre les « bonnes sciences » et les « mauvaises ». Car, ce qui compte est la vulnérabilité des « bonnes sciences » à l’alliance avec ceux qui donneront un tout autre sens qu’elles à l’abstraction.
La grande réussite de l’affaire des OGM, c’est que le conflit a mis en lumière ce que les promoteurs avaient décidé d’ignorer, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que cela puisse compter.
Les chercheurs ont été formés à considérer que c’est la réponse obtenue qui compte, parce qu’elle fait avancer la connaissance. Mais, pour leurs alliés industriels et étatiques, l’abstraction, l’élimination de ce qui fait obstacle à la méthode scientifique, devient ce qui permet une redéfinition active et unilatérale du monde.
Et cette redéfinition n’est jamais neutre. Car, les innovations dérivées des réponses scientifiques ne resteront pas « hors sol » − elles vont « révolutionner » ce sol, conférer un rôle dominant à ce que l’abstraction fait compter, vider de leur sens ou détruire activement ce qu’elle n’a pas pris en compte – et ce sera typiquement le cas des savoirs et des pratiques dites « non-scientifiques ».
Lorsqu’une invention technoscientifique est passée, le « sol » – la manière dont consiste le monde qu’elle concerne – est transformé. Ceux et celles qui lui étaient attachés sont séparés de leur savoir, désormais disqualifié, et deviennent les utilisateurs dépendants de dispositifs technoscientifiques dont les tenants et aboutissants leur échappent, ou leur sont indifférents, en tout cas, demandent leur soumission.
L’institution scientifique a canalisé l’imagination des chercheurs en les séparant systématiquement d’une culture des conséquences.
Que serait une institution prenant au sérieux la question de la responsabilité ? Très loin de se protéger par de beaux discours et des déclarations d’intention, ce serait une institution qui s’organise pour que cette question « fasse prise ».
Non une institution souveraine, qui « prend ses responsabilités », mais une institution qui prend acte de la nécessité de considérer comme un piège les habitudes de soumission, que ce soit celles de ceux qui en font partie ou celles de son milieu. Ce serait une institution qui sait qu’elle doit s’exposer aux conséquences de ce qu’elle promeut.
Et c’est précisément ce que n’a pas fait « la science », lorsque, mettant systématiquement en avant les bienfaits que l’avancée de la connaissance a apportés à la société, elle :
> a canalisé l’imagination des chercheurs, les a systématiquement séparés d’une culture des conséquences, leur a proposé le beurre – ne pas perdre leur temps à s’intéresser aux « dommages collatéraux » – et l’argent du beurre – revendiquer la responsabilité des « bénéfices ».
> a découragé les recherches qui sont moins orientées vers cette « avancée de la connaissance » que vers la « pertinence de la connaissance », des recherches qui impliquent la participation active de celles et ceux qui sont concernés par une situation, non l’extraction de ce qui, dans cette situation, peut être redéfini dans des termes qui permettront l’application d’une méthode scientifique.
A part les ethnologues, qui en cultivent la tradition, quels chercheurs peuvent-ils prendre le temps d’apprendre « sur le terrain »[11]− Lire le « Grand Entretien » de Jean-Pierre Olivier de Sardan, « Il y a de multiples points de vue idéologiques sur le développement », 15 mars 2017. / ce qui importe à ceux qui en ont la pratique ? Où publieront-ils la manière dont ils ont appris, « avec » les acteurs concernés, comment, ou à quelles conditions, ce qu’ils savent pourraient être éventuellement pertinent ? Où les jeunes chercheurs liront-ils l’analyse de ces expériences qui pourraient susciter leur intérêt, les empêcher de se prendre pour des missionnaires de la rationalité ?
La question de la responsabilité des sciences, toute utopique qu’elle puisse sembler, revêt une pertinence politique qui pourrait être cruciale.
> a toléré, voire encouragé, les promoteurs d’innovation à diffuser en toute impunité quasi-mensonges et demi-vérités, à disqualifier au nom de la rationalité ceux qui objectent, c’est-à-dire à déshonorer cette rationalité dont elle se prévaut, qui demande objections et contre-expertises.
Ce faisant, elle a favorisé une attitude défensive, considérant que la propagande, ce qu’on appelle aujourd’hui la « communication », est acceptable pour maintenir le public « à sa place », celle de bénéficiaire reconnaissant. Elle a bien dû accepter du bout des lèvres la nécessité pour une innovation d’être « acceptée », mais sans s’intéresser aux dispositifs, tels les conventions citoyennes, qui confèrent aux citoyens les moyens de prendre effectivement position quant aux arguments qu’on leur propose.[12]− NDLR : Voir la vidéo de la soirée-débat organisée par Sciences Critiques le 24 février 2017, La recherche et les technosciences en débat. /
Quant à l’idée d’une élaboration démocratique des orientations et des choix de recherche, il ne peut en être question. Toute mise en discussion risquerait de révéler les stéréotypes affligeants qui tiennent lieu de rapport entre champs de recherche. Les raisons guidant les arbitrages doivent rester une boîte noire laissant libre jeu aux lobbies, aux « baronnies », aux relations privilégiées.
Il devrait être assez clair que l’institution d’aujourd’hui, qui n’a même pas su lutter pour sauvegarder son héritage orgueilleux, qui s’est soumise à l’économie de la promesse et aux mirages de la croissance, est incapable, face à la crise générale, tant écologique que sociale, que nous connaissons, d’une autre réponse que celle attribuée à l’autruche.
Mais, c’est peut-être précisément l’inadéquation flagrante entre le type de savoir que promeut cette institution et les préoccupations de notre époque qui peut alimenter des alliances inédites.
Même si la mutilation de l’imagination des chercheurs se poursuit de plus belle, il n’est pas dit qu’elle tienne. C’est-à-dire qu’elle puisse les insensibiliser longtemps, car les questions « qui ne font pas avancer le savoir » pourront de moins en moins être ignorées.
Ébranler cette institution vermoulue et déshonorée qu’on appelle « la science ».
C’est pourquoi, la question de la responsabilité des sciences, toute utopique qu’elle puisse sembler, revêt une pertinence politique qui pourrait être cruciale.
Elle pourrait devenir une « affaire publique », appropriée tant par les chercheurs devenus récalcitrants que par ceux qui cesseraient de subir les arguments d’autorité scientifique. Et, en tant que telle, elle atteindrait un point névralgique du fonctionnement de l’institution, sa définition de la « vraie » connaissance comme se devant d’être « hors sol », c’est-à-dire hors responsabilité.
Par les temps qui courent, nous n’avons pas besoin de scientifiques cyniques, désespérés, ni même saisis par la culpabilité.
Nous avons besoin de scientifiques qui apprennent à rencontrer des interlocuteurs porteurs de questions qui importent, qui ne sont pas « anti-science »[13]− NDLR : Lire la tribune libre de Fabrice Flipo, Y’a-t-il des « antiscience » ?, 7 décembre 2015. / mais qui leur demandent de poser, avec eux, des questions que leur institution les a incités à ne pas poser. Car, ce sont eux qui, montrant le « mauvais exemple », pourraient ébranler cette institution désormais vermoulue et déshonorée qu’on appelle « la science ».
Isabelle Stengers
> Photo panoramique 1 : Liam Wilde / Licence CC.
> Dessin : couverture de la revue Survivre, juin-juillet 1971.
> Photo panoramique 2 : U.S. Army / Licence CC.
* * *
Notes[+]
| ↑1 | − Cité in Rémi Barré, « Des concepts à la pratique de l’innovation responsable : à propos d’un séminaire franco-britannique », Natures Sciences Sociétés, 19, 2011, p. 405-409. / |
|---|---|
| ↑2 | − NDLR : Lire le texte de Geneviève Azam, Dominique Bourg et Jacques Testart, Subordonner les technosciences à l’éthique, 15 février 2017. / |
| ↑3 | − NDLR : Lire la tribune libre de Joël Decarsin, Impasse de la technoscience, 29 septembre 2015. / |
| ↑4 | − NDLR : Lire le « Grand Entretien » de Joël Spiroux de Vendômois, « Le XXIème siècle doit devenir le siècle de l’hygiène chimique », 10 juin 2016. / |
| ↑5 | − NDLR : Lire la tribune libre de Jacques Testart, Pourquoi et comment être « critique de science » ?, 16 février 2015. / |
| ↑6 | − « L’histoire des OGM n’est pas une controverse ratée mais un conflit réussi », Socio-Informatique et Argumentation, décembre 2010 (Disponible en ligne). / |
| ↑7 | − Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Seuil, 2013. / |
| ↑8 | − Je me permets de renvoyer à mon livre, dont c’est le thème central : Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2013 (mentionné dans notre« Bibliothèque »). / |
| ↑9 | − NDLR : Voir notre dossier : Les OGM peuvent-ils nourrir le monde ?, 23 mai 2015. / |
| ↑10 | − Voir le blog de Pierre Calame. / |
| ↑11 | − Lire le « Grand Entretien » de Jean-Pierre Olivier de Sardan, « Il y a de multiples points de vue idéologiques sur le développement », 15 mars 2017. / |
| ↑12 | − NDLR : Voir la vidéo de la soirée-débat organisée par Sciences Critiques le 24 février 2017, La recherche et les technosciences en débat. / |
| ↑13 | − NDLR : Lire la tribune libre de Fabrice Flipo, Y’a-t-il des « antiscience » ?, 7 décembre 2015. / |