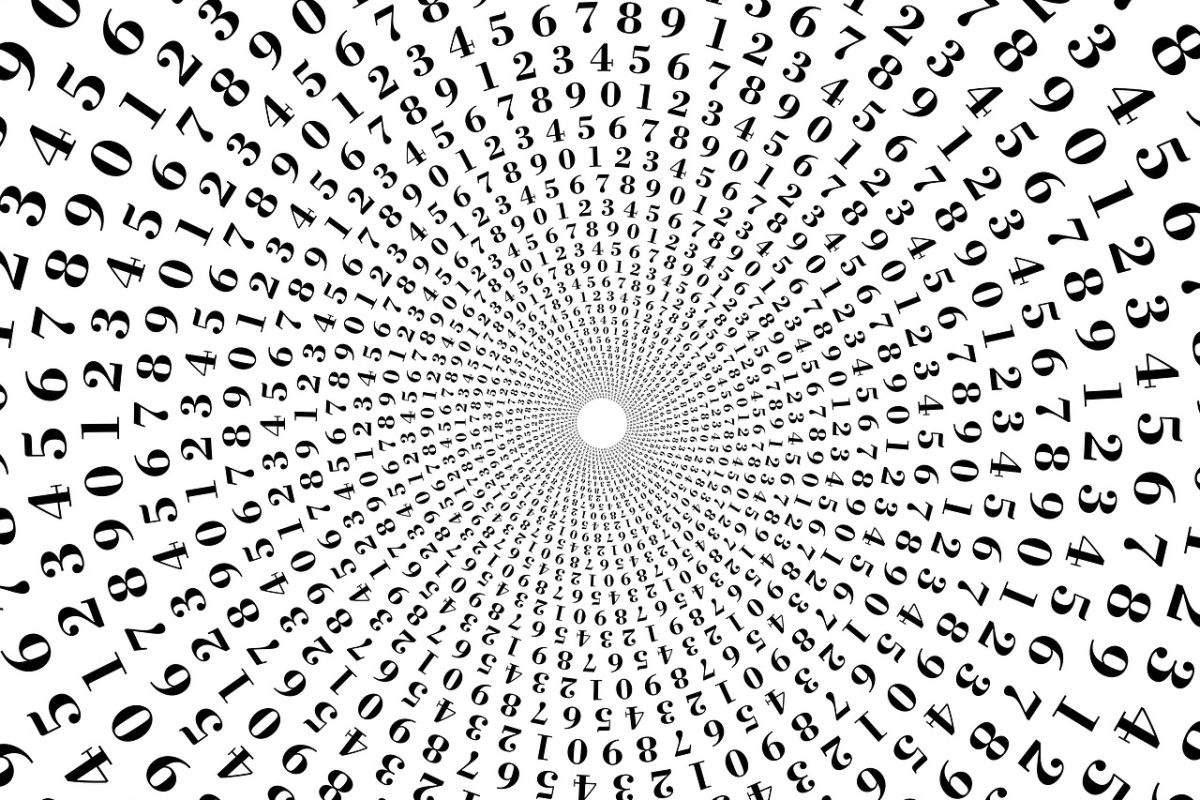[Retour à la Une*] « Publish or perish » (« publier ou périr » en français). L’expression n’a jamais été aussi vraie qu’aujourd’hui. Si la publication d’articles dans des revues scientifiques est devenue le « Graal » pour les chercheurs, cette injonction à la reconnaissance académique ne va pas sans poser problème vis-à-vis de leur travail et de la recherche elle-même. Trois questions à Roland Gori, psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille.
* * *
Sciences Critiques – En mars 2015, une étude publiée dans Journal of Informetrics révélait la « croissance exponentielle » du nombre d’articles paraissant dans les revues à comité de lecture… Que vous inspire cette prolifération des publications scientifiques ?

Roland Gori − Cette prolifération des publications scientifiques se révèle comme le symptôme de la maladie qui frappe aujourd’hui la recherche. Les enseignants, les doctorants et les laboratoires sont évalués sur le nombre de leurs publications et sur l’impact factor des supports dans lesquels ces travaux paraissent. Le langage de l’évaluation atteste lui-même le martyr auquel on soumet les dispositifs de recherche. On parle de « production » et de « rendement » scientifiques. Et ne sont pris en compte, parmi les critères d’évaluation, que la partie visible du travail. Le reste ne compte pas. La concurrence accroît l’importance de la visibilité sociale aux dépens de l’amour du métier et de la curiosité du chercheur.
Dans cette évaluation quantitative, formelle et procédurale, ne compte que le court terme, les résultats immédiats et leur transformation en marchandises et en spectacles. La valeur est ici réduite à la pensée des affaires, ce qui est compté, et à la pensée du droit, ce qui est conforme à l’hégémonie culturelle d’un réseau, d’un pays ou d’une langue. Cette financiarisation des activités de recherche est une véritable catastrophe culturelle qui favorise le conformisme comme l’imposture.
La financiarisation des activités de recherche est une véritable catastrophe culturelle qui favorise le conformisme comme l’imposture.
Du coup, les publications scientifiques sont inévitablement soumises à l’obsolescence programmée. Les revues ne sont plus des lieux de communication et de partage des chercheurs, mais les indispensables vitrines qui font d’un laboratoire ou d’un enseignant une personnalité de marque. Du coup, les revues scientifiques ne sont plus faites pour être lues mais simplement permettent de publier des articles short and dirty, moyens comme un autre d’accroitre son facteur H ou M. Donc, on publie beaucoup, non pas parce qu’on a quelque chose à dire, mais parce qu’il faut rester connectés. C’est le Facebook des communautés scientifiques contrôlé par des censeurs dont la censure ne porte pas sur le contenu des messages mais sur les conditions de production et d’accès. Un jour viendra où les futures générations n’auront que mépris pour ces fabriques de servitude volontaire que sont devenues nos institutions.
Quelles sont les conséquences de cette « frénésie évaluative » sur la recherche scientifique et les chercheurs ?
Les conséquences sont variables selon les pays, les disciplines universitaires et le niveau de recrutement des chercheurs. Les jeunes chercheurs sont managés avec férocité, parfois jusqu’à l’humiliation, pour devenir productifs. Les régions du monde les plus avantagées sont incontestablement les pays anglo-américains, pour lesquels la moindre des publications locales devient, aux yeux des négriers de la recherche, une publication internationale, alors même qu’une excellente publication espagnole ou hongroise demeurera toujours locale jusqu’au moment où elle sera racolée par une revue anglo-américaine.
Les jeunes chercheurs sont managés avec férocité, parfois jusqu’à l’humiliation, pour devenir productifs.
Friedrich Nietzsche, visionnaire, avait anticipé cette dégénérescence de l’aspect de curiosité et du goût pour la recherche lorsqu’il écrivait dans Considérations inactuelles : « Croyez-moi : si les hommes doivent travailler et produire dans l’usine de la science avant de parvenir à maturité, la science sera bientôt ruinée, de même que les esclaves trop tôt employés dans cette usine. Je regrette qu’il faille utiliser le jargon des négriers et des patrons pour traiter de matières auxquelles l’utilité et le besoin matériel devraient rester étrangers, mais les mots « usines, marchés du travail, offre, productivité » − avec toute la terminologie usuelle de l’égoïsme − viennent inévitablement aux lèvres lorsqu’on veut dépeindre la nouvelle génération de savants. »
Bien évidemment, c’est au sein des humanités que cette pensée de l’évaluation et de la recherche provoque les dommages collatéraux les plus importants.[1]− NDLR : Lire le texte du collectif Pièces et Main-d’Oeuvre (PMO), « Les deux cultures », ou la défait des humanités, 25 septembre 2016. / Claude Allègre, en France, s’est révélé comme le thuriféraire des humanités. Le droit et la médecine ont résisté plus longtemps à cette mise aux normes des censeurs grâce au conservatisme de leurs institutions, mais progressivement leurs « facultés » adoptent les mêmes manières de se soumettre aux normes que les disciplines littéraires et scientifiques.
Quels pourraient être les conditions et les outils adaptés à la réalisation d’une recherche scientifique réellement de qualité ?
En un mot comme en cent, je suis favorable à une biodiversité des modes d’évaluation qui respectent la spécificité des disciplines scientifiques et des modes de connaissance. On ne peut pas mesurer avec le même instrument des secteurs hétérogènes de la recherche, pas davantage que l’on peut arpenter un champ de maïs de la même manière que l’Himalaya ou un fonds sous-marin. Sauf à vouloir promouvoir pour des raisons idéologiques en phase avec la colonisation des mœurs par le néolibéralisme.[2]− NDLR : Lire la tribune libre d’Eric Berr et Léonard Moulin, La mise en marché de l’Université, 24 janvier 2017. /
Je suis favorable à une biodiversité des modes d’évaluation qui respectent la spécificité des disciplines scientifiques et des modes de connaissance.
Certains critères d’évaluation ont des affinités électives avec le langage des maîtres du monde, et leur utilité sociale et politique − au sens de Pierre Bourdieu − prévaut sur la pertinence épistémologique. Il est évident qu’une évaluation quantitative et formelle se révèle davantage adaptée aux disciplines scientifiques qu’aux humanités. Ce type d’évaluation sera favorisé par le néolibéralisme, puisqu’il invite à une civilisation des mœurs et une conception du monde où tout est numérisé, transformé en marchandise, soumis à la concurrence et à la vitesse. Encore que, nombreux sont les scientifiques qui se plaignent de cette manière de penser la valeur et de censurer leur production.[3]− NDLR : Lire la tribune libre de Christian Laval, La sociologie contre le néolibéralisme, 28 février 2017. /
De la même manière, s’il convient de favoriser le partage et la confrontation internationale des travaux de recherche, il est absurde de le faire sur la base du globish qui est devenu l’esperanto du monde des affaires comme de celui de l’université. L’anglo-américain devient le « cheval de Troie » d’une manière de penser le monde qui se révèle hégémonique et partisane de l’utilitarisme anglo-américain. C’est à chaque communauté scientifique de décider des critères les mieux adaptés à ses objets et à ses méthodes. Face à la globalisation de la recherche, réalisée avec le même logiciel que la globalisation marchande, il faut réhabiliter le local. Local n’est pas un gros mot. C’est le mot du concret, du singulier, de l’histoire et du vivant.
Il convient, à mon avis, de faire en sorte que les chiffres que l’on utilise soient, d’une part, pertinents et, d’autre part, qu’ils soient là pour nous permettre de parler, et non pas pour nous obliger à nous taire.[4]− NDLR : Lire la tribune libre de Simon Charbonneau, L’empire idéologique des chiffres, 27 août 2016. / En un mot comme en cent, pour réhabiliter les lieux de débats et d’échanges entre chercheurs, évaluer sur le long terme les résultats des travaux de recherche, évaluer les chercheurs, non pas sur les produits voués à l’obsolescence des marchandises et du spectacle, mais sur leur véritable activité de production. Enfin, en ce qui concerne les universitaires, il est absurde de ne les évaluer que sur la recherche alors même que les activités d’enseignement, de gestion et de vulgarisation sont essentielles dans leurs missions. La démocratie dans la recherche, ce n’est pas pour demain.[5]− NDLR : Lire notre « Grand Entretien » avec Jean-Marc Lévy-Leblond, « Il n’y a pas de maîtrise démocratique de la science », 19 décembre 2015. / Il faut abattre les classements type Shanghai comme on a pris la Bastille.
Propos recueillis par Anthony Laurent, rédacteur en chef / Sciences Critiques.
*Parce que les écrits, même sur Internet, ne restent pas toujours, nous avons entrepris en 2024 de republier 30 des textes (tribunes libres, « Grands Entretiens », reportages, enquêtes…) que nous avons mis en ligne depuis février 2015. Ce « Trois questions à… » a été publié pour la première fois le 27 septembre 2017.
* * *
Notes[+]
| ↑1 | − NDLR : Lire le texte du collectif Pièces et Main-d’Oeuvre (PMO), « Les deux cultures », ou la défait des humanités, 25 septembre 2016. / |
|---|---|
| ↑2 | − NDLR : Lire la tribune libre d’Eric Berr et Léonard Moulin, La mise en marché de l’Université, 24 janvier 2017. / |
| ↑3 | − NDLR : Lire la tribune libre de Christian Laval, La sociologie contre le néolibéralisme, 28 février 2017. / |
| ↑4 | − NDLR : Lire la tribune libre de Simon Charbonneau, L’empire idéologique des chiffres, 27 août 2016. / |
| ↑5 | − NDLR : Lire notre « Grand Entretien » avec Jean-Marc Lévy-Leblond, « Il n’y a pas de maîtrise démocratique de la science », 19 décembre 2015. / |