[Retour à la Une*] Alors que la catastrophe nucléaire de Fukushima se poursuit, dans l’indifférence quasi générale, depuis plus de dix ans maintenant, le gouvernement japonais a mis en œuvre, dès le lendemain de l’accident, une « politique de résilience » enjoignant la population à vivre, quoi qu’il en coûte, avec la contamination radioactive, au péril de nombreuses vies humaines. C’est cette nouvelle « idéologie de l’adaptation », cette dernière-née des « technologies du consentement », que Thierry Ribault analyse et critique sans concession dans son livre Contre la résilience. A Fukushima et ailleurs (L’Echappée, 2021). A l’heure du dérèglement climatique et de la pandémie de Covid-19, le sociologue met en garde contre cette énième « imposture solutionniste de notre époque ».
* * *
Sciences Critiques – Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Vise-t-il, à travers l’analyse de la politique de résilience mise en œuvre par le gouvernement japonais après l’accident de Fukushima, à (re)politiser la question du nucléaire et ses risques dans nos sociétés industrielles ?
Thierry Ribault – Je rends hommage à Nadine Ribault, avec qui nous avons fait paraître en 2012 Les Sanctuaires de l’abîme. Chronique du désastre de Fukushima. Jusqu’aux dernières semaines précédant sa mort, le 15 janvier 2021, après deux ans de soin pour un cancer des voies biliaires, sa résolution à combattre ce qu’elle appelait la « contre-vie », et la justesse de ses visions du monde, ont donné à ce Contre la résilience. À Fukushima et ailleurs, ce qu’il peut avoir de plus pertinent.
Il n’existe désormais plus aucune catastrophe, personnelle ou collective, dont les défenseurs de la résilience ne se saisissent en exhortant chacun à faire de sa destruction une source de reconstruction, et de son malheur celle de son bonheur.
Le désastre de Fukushima n’y échappe pas, même si, l’idée de base des partisans de l’accommodation, selon qui être résilient signifie non seulement être capable de vivre malgré l’adversité et la souffrance, mais surtout être capable de vivre grâce à elles, de grandir et s’adapter par la perturbation et la rupture, est en réalité inapplicable dans le monde de la radioactivité, comme dans nombre de situations d’exposition toxique ou de contamination.
La critique de la politique de résilience à Fukushima est une heuristique pour comprendre comment et pourquoi les politiques publiques prétendant répondre aux désastres du techno-capitalisme – des politiques anti-Covid-19 aux plans de lutte contre le réchauffement climatique – s’inscrivent dans cette nouvelle religion d’État qu’est la résilience.
Comment le concept de résilience est-il passé de la science des matériaux à une « technologie du consentement » des populations aux catastrophes en cours et à venir ?
La résilience a essaimé de manière normative dans la sociologie et la psychologie. À l’aube des années 1950, son irruption dans l’écologie est édifiante, avec les travaux menés pour le compte de la commission de l’énergie atomique américaine par les biologistes Eugene et Howard Odum sur les réactions des atolls coralliens, et accessoirement des hommes, aux particules radioactives des essais atomiques dans le Pacifique.
De là naîtra « l’écologie des radiations », ancêtre de l’écologie systémique, qui étudie la capacité du vivant à s’adapter à sa destruction. Une version plus libérale va s’imposer à partir des années 1970, prônant la capacité à tirer parti des chocs et à capitaliser sur les opportunités émergentes.
L’idée de base des partisans de l’accommodation est en réalité inapplicable dans le monde de la radioactivité, comme dans nombre de situations d’exposition toxique ou de contamination.
Loin d’une simple rhétorique, la résilience est une technologie du consentement. À la fois un discours tenu sur la technique et une technique elle-même, dont la finalité est d’amener les populations en situation de désastre à consentir à la technologie − à Fukushima il s’agit du nucléaire − ; à consentir aux nuisances, en rendant incontournable le fait de « vivre avec » ; à consentir à la participation, à travers la cogestion des dégâts qui déresponsabilise les responsables ; à consentir encore à l’ignorance, en désapprenant à être affecté par ce qui nous touche au plus profond, notre santé notamment ; à consentir, enfin, à expérimenter de nouvelles conditions de vie induites par le désastre.

La résilience, écrivez-vous, se nourrit de la « science non faite », de l’« ignorance organisée », qui ne se réduit pas simplement aux mensonges des autorités et ne résulte pas simplement de l’instrumentalisation de la science par les industriels, mais qui « fait partie intégrante de l’appareil de production scientifique ». C’est-à-dire ?
Mensonges, mises sous secret et collusions entre science, industrie et État sont amplement documentés. Mais l’ignorance organisée relève des apparences socialement nécessaires, de l’idéologie plutôt que du mensonge, de la justification plutôt que des techniques de persuasion. Elle opère un rétrécissement cognitif permettant d’aménager, sans contradiction, une réalité contradictoire : vivre en toute plénitude dans un milieu nocif.
Il s’agit de préserver le statu quo autour d’une représentation acceptable du désastre et de ses dégâts. À Fukushima, que ce soit par les espaces géographiques scotomisés [, la dose reçue par les populations qui reste inconnue, l’amplitude limitée des enquêtes sanitaires et environnementales, ou les atteintes psychologiques éludées ou détournées, l’objet étudié est systématiquement réduit, générant des zones de science non faite.
Il s’agit moins de cacher que d’instiller dans les esprits et les pratiques l’idée qu’avec moins ou peu de connaissance, on peut s’en tirer mieux qu’avec trop.
La gestion par les « seuils » d’insécurité, revus à la hausse, relève de l’ignorance organisée : tant qu’ils ne sont pas dépassés, l’évaluation du risque ne requiert pas d’action supplémentaire, tablant sur les capacités de chacun à faire front aux effets délétères. Il s’agit moins de cacher que d’instiller dans les esprits et les pratiques l’idée qu’avec moins ou peu de connaissance, on peut s’en tirer mieux qu’avec trop.
Rapidité accrue, recours minimisé aux ressources, gains en légitimité politique face aux pressions du public sont autant d’avantages organisationnels pour les administrateurs du désastre, dont l’objectif est de rassurer vite et au moindre coût. En savoir progressivement de plus en plus sur de moins en moins est un cadre cognitif parfaitement ajusté au fonctionnement en mode dégradé préconisé par les affidés de la résilience.
Vous écrivez que « la résilience est l’un des avatars de la machine cybernétique. » Pourquoi ?
Transformant le vivant en une machine à souffrir et à encaisser les coups pour mieux rebondir, la résilience est en cohérence avec le systémisme qui préside à son modèle, la cybernétique, où ce qui est nocif ne l’est jamais objectivement, mais dépend de l’individu-récepteur sur lequel porte l’agression et de son degré de préparation, donc aussi d’impréparation.
C’est bien l’impératif de « préparation » qui fonde la « transition écologique et climatique » tant attendue par la loi « Climat et résilience ». Préparation par l’éducation, l’« accélération de l’évolution des mentalités » et la responsabilisation individuelle. Nos forces intérieures deviennent les jauges des agressions extérieures, dont le degré de sévérité dépend de chacun.
D’où la sur-responsabilisation qui sous-tend la résilience dans un monde où il n’y a plus de violence objective. La catastrophe devient une perturbation introduisant de nouveaux éléments d’information dans un système autorégulé, chargé de les capter et de les intégrer, donnant à chacun l’opportunité de sortir de sa « zone de confort » et d’affronter les turbulences à venir. Bref ! De progresser en tirant des leçons d’adaptation au pire.
Avec le nucléaire, depuis au moins l’accident de Tchernobyl en 1986, comme actuellement avec la crise pandémique du Covid-19, diriez-vous que les populations sont considérées comme les cobayes d’expériences « grandeur nature » réalisées à ciel ouvert à l’occasion d’accidents industrielles ou de catastrophes naturelles ?
À Fukushima et ailleurs, les gens sont déplacés dans un monde qui les menace, auquel ils sont inappropriés. Privés de leur monde, ils voient en tout acte et en toute chose un moyen de retourner au milieu qui est le leur : d’où l’obsession de la décontamination, le mythe du village natal, qui procurent l’espoir de revenir à « la situation initiale ». On tente de se soigner par le retour.
Aller à l’encontre de ce désir de retour, qui est en fait un désir refoulé de fuir l’impossibilité de maintenir la vie dans un milieu hostile, est une gageure qu’aucun pouvoir ne peut relever : on s’abrite derrière l’illusionnisme d’ « une radioactivité qui fait partie du monde ». Il s’agit de se rendre disponible pour un monde dont on ne peut disposer, un monde faux qui dispose de nous. D’où la domestication de la peur prônée par les adeptes de la résilience, un pas de plus vers l’abolition de la prise de conscience de la falsification du monde, et vers une paralysie de la raison par la crainte de la vérité et de la liberté.
La résilience transforme le vivant en une machine à souffrir et à encaisser les coups pour mieux rebondir.
L’enfermement dans une vie calculée, où l’on quantifie les risques, on évalue ses chances de survie, on l’organise en optimisant son comportement, et où l’on s’endurcit pour faire face au désastre et s’en nourrir, est aux antipodes du fait de ressentir la menace, d’en devenir pleinement conscient, y compris par la peur, de fuir cette menace et de s’attaquer à ses causes réelles. On apprend à vivre avec, à gérer sa dose avec le minimum de connaissance, dans un système socio-technique perpétuellement en voie de remédiation. On devient une ressource au service des « capacités à entrer en résilience » de ce système.
Quelle est la fonction politique et idéologique de la résilience ? Représente-t-elle un nouvel eugénisme, en favorisant les plus aptes à s’adapter, destiné in fine à sauver, quoi qu’il en coûte en vies humaines, la société techno-industrielle face à ses propres catastrophes (accidents nucléaires, épidémies, dérèglements climatiques, pollutions…) ?
La résilience est une métaphysique étatique du malheur qui justifie le désastre comme le pendant inéluctable du progrès, au point d’en faire sa source. Il y a une dimension sacrificielle dans ce culte de l’adaptation. Le coup de force eugénique de la résilience est de soutenir que la catastrophe n’est pas ce qui survient, mais l’impréparation individuelle et collective à ce qui survient. D’où, chez Sanofi, ce système de promotion ciblé pour les salariés dotés de la « qualification fighting cancer », car « l’ex-malade a de quoi transmettre à ses pairs ». Une fois le tri effectué. Dans cette recherche insensée de liaisons vertueuses entre souffrance, mérite et héroïsme, l’abomination n’a plus de limite.
Comment les organisations et les experts internationaux spécialisés en radioprotection (UNSCEAR, OMS, AIEA, CIPR…) participent-ils à la normalisation des accidents nucléaires ? Et que pensez-vous de la stratégie des mouvements anti-nucléaires en matière de contre-expertise dans ce domaine ?
Dans sa promesse de réparation individuelle et collective, la résilience institue les victimes en cogestionnaires du désastre. On légitime ainsi la production organisée d’ignorance et la logique selon laquelle il faut avant tout apaiser les esprits de manière efficace.
À Fukushima, qu’elle soit citoyenne, libertarienne techno-centrée, ou copilotée par des représentants des autorités et des experts, la cogestion participe de l’élaboration du consentement au désastre et à ses suites. Elle tend à reproduire le monde administré en réaction duquel on est censé se situer. Elle fétichise les moyens pour éviter de réfléchir aux fins. Elle contribue à la confusion entre l’accomplissement du sujet et les nécessités que lui impose sa survie en milieu toxique. Elle alimente en contre-expertise la machine à produire de la controverse. Elle collabore enfin au développement de l’appareillage technique des États préparant la gestion du prochain désastre.
Dans sa promesse de réparation individuelle et collective, la résilience institue les victimes en cogestionnaires du désastre.
On est bien loin de l’objectif d’autonomie citoyenne. On répond au lobby par le hobby de l’activisme, dont le caractère régressif réside dans son refus de faire réflexion sur sa propre impuissance. Comme le résume un ex-membre d’une organisation citoyenne, « le laboratoire citoyen devient une activité en soi, un business qui tourne ».
Que pensez-vous de la controverse, savamment entretenue depuis des décennies, sur les effets des « faibles doses » de radioactivité sur la santé humaine ?
Que ce soit la betterave sucrière ou le nucléaire, il y a toujours une filière à sauver. La confusion est entretenue entre, d’une part, l’incertitude relative à la signature biologique du cancer et, d’autre part, la supposée incertitude relative au lien épidémiologique entre faible exposition et risque de cancer. Alors que la seconde incertitude est en grande partie le fruit d’une controverse artificiellement nourrie, une incertitude volontaire en quelque sorte, la première est bien réelle, mais elle vaut pour nombre de cancers et pas seulement pour les cancers radio-induits.
Qu’il n’y ait pas d’exception des rayonnements ionisants du point de vue de la difficulté à établir la preuve biologique de leur nocivité en termes de cancer ne disculpe pas pour autant les nuisances radioactives − ni les autres d’ailleurs −, d’autant moins que même à faible dose, les effets nocifs de certaines molécules se renforcent lorsqu’elles sont combinées, agissant en synergie sur les cellules et produisant des conséquences délétères inattendues, phénomène frivolement qualifié d’« effet cocktail ».
Vous citez cette phrase de René Riesel et Jaime Semprun dans Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable (Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2008) : « C’est la révolte, le goût de la liberté, qui est un facteur de connaissance plutôt que le contraire. » C’est-à-dire ?
Déplorer la production d’ignorance en arguant que si la connaissance dont elle nous prive était disponible, tout serait transparent et qu’une action enfin rationnelle en découlerait, relève d’une vision naïve, source de confusion. Chaque fois que la connaissance aura des chances de mener à une action socialement inacceptable, ayant des conséquences douloureuses du point de vue de la préservation de la totalité sociale – par exemple, évacuer les villes d’Iwaki, Fukushima et Kôriyama de 300 000 habitants chacune –, elle ne se transformera ni en action ni en force d’émancipation.
Arguer que si la connaissance était disponible une action enfin rationnelle en découlerait relève d’une vision naïve.
Rendre publique la connaissance en pensant que cette mise à disposition sera automatiquement effective en termes de décision est illusoire, car la clef de la transformation de la connaissance en action n’est pas, et ce de plus en plus, la disponibilité de son contenu, mais la disponibilité de ceux qui s’en emparent, c’est-à-dire la manière dont les individus sont préparés et rendus susceptibles d’être mis à disposition de la société. Seules les failles dans cette mise à disposition, par où le désir de liberté qu’elle séquestre peut trouver à s’exprimer et à prendre forme, sont susceptibles de révéler et activer le potentiel anti-régressif de la connaissance.
Si la résilience est une « imposture solutionniste », comme vous l’écrivez, comment faire face, voire échapper, aux désastres qui nous menacent ?
Cesser par tous les moyens possibles de considérer le malheur comme un mérite. Lui donner la parole certes, mais non pas pour lui donner un sens afin de mieux l’évacuer. Apprendre à nommer ce malheur et faire advenir à la conscience la dureté de ce qui est, plutôt que se résigner aux rapports sociaux et à leurs nuisibles sous-produits. Sortir de l’exaltation du sacrifice et de la souffrance, inversement proportionnelle aux efforts déployés pour en être épargnés. Vivifier le désir de prendre distance vis-à-vis de la condition de survivant. Reconnaître notre impuissance, y compris technologique, face aux désastres, en prendre acte et en tirer les conséquences.
Au vu de la radicalité de vos critiques, d’aucuns pourraient vous considérer comme « un semeur de panique », pour reprendre l’expression du philosophe allemand Günther Anders. Vous considérez-vous comme tel ?
Lorsque les neurophysiologues ambitionnent d’« inhiber les neurones de la peur » par l’optogénétique afin d’ « éteindre la peur » dans les cerveaux pour mieux étreindre notre malheur, on peut se demander de quel côté se trouve la radicalité. La peur n’a plus lieu d’être, devient une question de perception qu’il faut apprendre à commuter pour mieux conclure un accord à l’amiable avec le pire. Proclamer les vertus du courage, de l’endurance, de la solidarité, ne sert qu’à détourner de la peur, qui passe désormais pour une vanité ou une honte. On ouvre grand les portes à la légalisation des méthodes nécessairement criminelles visant à surmonter la peur pour faire front aux « ennemis ».
Reconnaître notre impuissance, y compris technologique, face aux désastres, en prendre acte et en tirer les conséquences.
Au prétexte de nous libérer de la peur, nous liquidons notre liberté d’avoir peur. Alors qu’elle est un moment indispensable pour prendre conscience des causes qui nous amènent à l’éprouver, la peur est devenue le symptôme d’une maladie de l’inadaptation que la résilience est censée soigner. La peur inquiète, comme le confirme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), soucieuse de « supprimer la peur de la pandémie de Covid-19 », à défaut d’en sortir. On peut comprendre les motifs d’un gouvernement par la peur de la peur, car elle peut stimuler en nous la colère et la nécessité de bouleverser une organisation qui se nourrit du désastre qu’elle génère.
Propos recueillis par Anthony Laurent, rédacteur en chef / Sciences Critiques.
*Parce que les écrits, même sur Internet, ne restent pas toujours, nous avons entrepris en 2024 de republier 30 des textes (tribunes libres, « Grands Entretiens », reportages, enquêtes…) que nous avons mis en ligne depuis février 2015. Cet entretien a été publié pour la première fois le 14 juillet 2021.
* * *


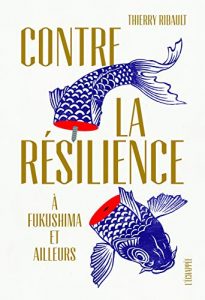







3 réponses
merci pour cette lecture
sujet et auteur fort intéressants, de quoi en faire de(s) podcast(s) ! 😉
La résilience est effectivement une des réponse du système visant à « l’acceptabilité de la situation », à ce titre elle est le contraire de la résistance ! Cultiver la conscience du caractère dramatique de la situation est indispensable. La peur doit être l’occasion d’éveiller notre conscience à l’ampleur du désastre et non pas à la paralyser ! Voir Hans Jonas sur « l’heuristique de la peur » !
Je suis en train de lire Stars War en BD, et j’en suis là,au moment où l’individu n’a plus aucune importance, il n’existe que pour servir un système, notamment sur les planètes usines, deux frères dieux s’affrontent,leurs soldats doivent mourir pour satisfaire leurs désirs de pouvoir, c’est comme ça,tous l’acceptent, avec »résilience »…
Merci pour cette analyse de ce que devient notre monde.