[Retour à la Une*] Bon nombre d’économistes, mais aussi les hommes d’affaires, les financiers, beaucoup d’élus politiques, une poignée de journalistes complices et influents sont passés de la déraison à la croyance en célébrant quotidiennement le culte de la croissance et, ce faisant, ils produisent un discours qui ne peut plus être scientifique car il s’apparente désormais à la conviction religieuse.
* * *
« Si donc avec M. Say, nous voulons faire de l’économie politique une science positive fondée sur l’expérience et susceptible de donner des résultats précis, il faut prendre le plus grand soin d’embrasser seulement, dans la définition du terme principal dont elle se sert, les objets dont l’accroissement ou la diminution peuvent être susceptibles d’évaluation. »
(Thomas Robert Malthus,
Principes d’économie politique considérés sous le rapport de leur application pratique, 1820)

C
AC 40, taux de chômage, Produit Intérieur Brut (PIB), croissance, dépenses publiques, taux d’endettement, politique de l’offre, relance par la demande, déficit budgétaire, flexibilité, austérité…
Des expressions familières, des repères statistiques, des sigles, des acronymes inscrits dans notre réalité quotidienne sans que pour autant chacun d’entre nous soit véritablement en mesure d’en livrer la signification précise.
Abstractions, outils entre les mains expertes de spécialistes de l’économie, de diplômés de grandes écoles européennes ou étatsuniennes à même de produire un discours économique d’une grande complexité parfois, de livrer des analyses ambitieuses et remarquées, susceptibles, dit-on, de nous éclairer sur la marche du monde.
L’économie s’est affirmée comme une discipline incontournable dont les théoriciens les plus zélés ont droit à quelques égards puisque depuis 1969 le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, converti abusivement en « prix Nobel d’économie », est décerné par l’Académie des sciences de Suède.
L’économie serait-elle suffisamment scientifique pour mériter cette reconnaissance ?
Curieusement, au moment où les bouleversements économiques, sociaux, énergétiques, écologiques, climatiques, menacent tout à la fois l’équilibre des forces politiques, économiques, militaires mais aussi et surtout la survie de l’humanité et de l’ensemble des espèces vivantes, la science économique rayonne.
L’économie transforme le monde mais le transforme seulement en monde de l’économie.
Pas un ingénieur, pas un mathématicien, pas un informaticien, pas un sociologue, pas un philosophe, pas un étudiant ou un lycéen ne saurait ignorer aujourd’hui le langage de l’économie.
Les sciences économiques et sociales sont d’ailleurs enseignées dans le secondaire depuis la fin des « Trente Glorieuses », à une époque fertile en évènements.
Au hasard : l’abandon par les Etats-Unis de la convertibilité du dollar en or, déstabilisant durablement les relations économiques internationales ; les différents chocs pétroliers révélateurs de l’incroyable dépendance à l’or noir des économies dominantes et subséquemment leur grande fragilité ou encore la catastrophe du Torrey Canyon, l’une des premières du genre − en attendant Tchernobyl et Fukushima −, qui allait éveiller à une nouvelle conscience écologique.
Sans doute, s’agissait-il de diffuser des savoirs scientifiques afin de mieux appréhender la réalité d’un monde sur le point de vaciller sous nos yeux !
Contentons-nous d’observer, à ce sujet, que près d’un demi-siècle plus tard, les remèdes apportés par les économistes n’ont pas apaisé nos angoisses ni rétabli une pleine confiance en l’avenir pour les victimes de ce que l’on persiste à appeler « la » crise.
Au lieu d’amorcer un changement salutaire de leur imaginaire, les hommes, guidés par les paroles lénifiantes de la plupart des économistes, s’engouffrent dangereusement dans une impasse.
Tant que la production matérielle des hommes demeura artisanale afin de répondre en premier lieu à une consommation domestique puis à des échanges du surplus entre des acteurs indépendants, elle fut contenue dans une fonction économique marginale.
Elle était inscrite dans l’organisation sociale des communautés humaines et échappait aux nécessités du marché concurrentiel.
Un romancier, un sociologue, un psychanalyste peuvent porter un regard singulier mais éclairé sur l’économie.
Mais dès qu’elle fut mise en contact avec l’accumulation capitaliste et confrontée à l’impitoyable concurrence des producteurs, elle se subordonna à la marchandise et à son développement quantitatif ininterrompu.
L’économie devint hégémonique et Guy Debord put déclarer dans les années 1970 : « L’économie transforme le monde mais le transforme seulement en monde de l’économie. »[1]− Guy Debord, La société du spectacle, Champ Libre, 1976, p. 25. /
Les économistes ont un complexe de supériorité et prétendent être les seuls à pouvoir parler savamment d’économie.
Or, par exemple, il est concevable d’aborder les problématiques de l’argent et du travail en lisant Zola.
Même si le piège de l’empirisme n’est pas, en l’occurrence, entièrement évité, convenons toutefois que la production de savoirs économiques pertinents n’est pas l’apanage des économistes.
Un romancier, un sociologue, un psychanalyste peuvent porter un regard singulier mais éclairé sur l’économie.
Les salariés victimes de la délocalisation de leur entreprise ont parfaitement ressenti la violence de la mondialisation.
Nul besoin ici de scientificité, dans le discours de protestation, dans les mots de la colère pour donner à la revendication toute sa force.
Ce triomphe inquiétant de l’économie n’est-il pas en partie imputable au succès grandissant du discours de l’économie politique, plus fréquemment appelée aujourd’hui la science économique ?
Le caractère scientifique de l’économie n’est qu’un leurre destiné à masquer son véritable objet : la marchandisation généralisée des hommes et de la nature.
Dit autrement, la production de connaissances largement répandues et qualifiées d’objectives, cohérentes, rigoureuses par les économistes eux-mêmes − lesquels se sont rendus maîtres des mots −, les lois économiques prétendument universelles, l’outillage mathématique sophistiqué n’éloigneraient-ils pas la science économique de ce qui devait être sa mission première : expliquer le fonctionnement de la vie matérielle des sociétés humaines ainsi que leur cheminement vers un bien-être collectif dénué de tout rapport de pouvoir.
Le détournement de son propos à des fins utilitaristes répond à une double nécessité idéologique : d’une part, nous empêcher de voir clairement la réalité d’un mode de production, d’un mode d’emploi de la nature et des hommes et en fin de compte d’un mode de vie collective qui se voudrait universellement partagé et d’autre part permettre, sans limites, sa reproduction.
Le caractère scientifique de l’économie n’est qu’un leurre destiné à masquer son véritable objet : réunir un ensemble de modalités d’actions, de techniques toujours plus efficaces en faveur des puissants de ce monde qui, de ce fait, s’autorisent, à l’appui d’une scientificité ayant toutes les apparences de la légitimité, la marchandisation généralisée des hommes et de la nature.
LA THÉORIE ÉCONOMIQUE FACE A LA RÉALITÉ
Si l’on voulait assurer à la science économique toute la respectabilité et la crédibilité souhaitables et, de toute évidence, souhaitées par tous ceux qui la servent au quotidien dans les Universités, les grandes écoles de commerce mais aussi sur les plateaux de télévision et les chaînes de radios nationales, sans oublier le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale, il conviendrait pour le moins, de leur proposer une confrontation entre la théorie économique et la réalité.
Pourtant, pareille initiative leur apparaîtra bien vite décevante et probablement décourageante.
En vérité, les « Trente Glorieuses » sont trente années ravageuses et dangereuses que les économistes n’ont pas voulu voir.
Ainsi, les richesses croissantes réalisées au sein des sociétés converties depuis longue date à l’économie de marché, et dont les économistes libéraux ne cessent de s’enorgueillir, se retrouvent en réalité entre les mains d’une minorité dominante.
La surabondance de biens à la disposition des plus riches côtoie le dénuement, parfois affligeant, des exclus de la modernité.
Plutôt qu’un véritable mieux-être généralisé, les « Trente Glorieuses », nourries de libéralisme, furent davantage l’occasion inespérée de freiner la progression des frustrations qui d’ailleurs devinrent insoutenables lorsque la crise sociale, économique et culturelle fut annoncée vers la fin des années 1970.
Certes, le plein emploi fut sauvegardé ! Quelques historiens bien inspirés évoquent aujourd’hui les « maux » de cette période de haute croissance, son contenu chimique et énergétique provoquant une destruction durable des sols et laissant une empreinte douloureuse sur les corps.
En vérité, ce sont trente années ravageuses et dangereuses qui se sont écoulées après-guerre et que les économistes n’ont pas voulu voir.[2]− Céline Pessis, Sezin Topçu et Christophe Bonneuil, Une autre histoire des « Trente Glorieuses ». Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre, La Découverte, … Continue reading
« L’échange lie entre elles toutes les nations du monde civilisé par les nœuds communs de l’intérêt, par des relations amicales et en fait une seule et grande société. » Qui peut encore aujourd’hui se réclamer de cette vision idyllique du commerce international décrite par David Ricardo en 1817 ?
Il faut être singulièrement insouciant et imprudent pour vouloir ignorer les enseignements de l’histoire économique récente.
Les nombreux travaux de recherche dans le champ économique n’ont en rien anticipé les chocs pétroliers des années 1970 ou encore la faillite de Lehman Brothers en 2008.
A l’issue du processus de décolonisation, l’échange économique entre le Nord et le Sud fut inégal puisque les économies naturelles et harmonieuses du Sud connurent une profonde déstructuration.
Une division internationale du travail, chère à Ricardo, généra une extraversion des pays pauvres, laquelle les subordonna très sévèrement aux économies du Nord plus riches. Force est de constater que le libre-échange ne génère pas d’échanges libres.
En vérité, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo escamote la mobilité du capital qui a pourtant favorisé la montée en puissance des firmes multinationales et jeté les bases d’une mondialisation sauvage.
En dépit de cette inadéquation entre théorie et réalité, les économistes de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), visiblement peu découragés, demeurent fidèles aux principes ricardiens.
Les nombreux travaux de recherche dans le champ économique, les rapports, les articles, les essais sur l’économie publiés par les milieux universitaires, l’outillage conceptuel forgé par les théoriciens de l’économie n’ont en rien anticipé des évènements aussi lourds de conséquence que les chocs pétroliers des années 1970, la déplétion désormais avérée des principales énergies fossiles ou encore la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, qui mit en péril les finances mondiales.
Ce même outillage intellectuel maintient, au sein de la pensée économique dominante, une représentation simpliste et mystificatrice du progrès technique.
Neutre et autonome, celui-ci stimulerait les économies comme la pluie arrose le sol aride pour le nourrir et le fertiliser.
Nous devrions donc nous adapter docilement à cette force magique et continue, à vivre dans le progrès pour espérer un nouveau progrès et nous tirer d’affaire.
Il nous faudrait, sur les recommandations de ses laudateurs, laisser se dérouler imperturbablement sa course folle en fermant les yeux sur les dégâts déjà observables et sur ceux qui ne manqueront pas d’advenir.
Si la science permet d’accéder à l’inconnu et d’éclairer le réel afin de nous le rendre plus lisible, il s’avère que la science économique a manqué sa cible.
Au nom du système technicien auto-entretenu et de la logique de la croissance, les hommes multiplient les innovations destinées à réparer les nuisances engendrées par les technologies elles-mêmes.
Si la science permet d’accéder à l’inconnu et d’éclairer le réel afin de nous le rendre plus lisible, il s’avère que la science économique, au regard des quelques exemples qui précèdent, a manqué sa cible. Impitoyable, la critique des faits la vulnérabilise un peu plus.
Pourtant, malgré le démenti apporté par la réalité, la science économique se maintient et les médias demeurent friands des commentaires, des expertises fournis par les économistes lorsqu’une nouvelle crise menace.
Paradoxalement, moins la science économique est susceptible de soulager nos inquiétudes, plus il semble indispensable d’y recourir pour mettre fin, illusoirement, à nos tourments.
En définitive, ce paradoxe soulève la question du langage de l’économie et de son contenu. Pour tenter d’y répondre, il ne serait pas inutile d’examiner une des ses nombreuses définitions.
DÉFINIR L’ÉCONOMIE
Pratiquement, chaque économiste de renom possède sa définition. Retenons l’une des plus connues, celle de Lionel Robbins : « L’économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre les fins et les moyens rares à usages alternatifs. »[3]− Lionel Robbins, Essai sur la nature et la signification de la science économique, Médicis, 1947, p. 29. Les collectionneurs seront peut-être intéressés par la définition de Raymond Barre, … Continue reading
Affirmer que la rareté est à la source de toute activité humaine semble incontestable mais demeure en réalité indémontrable.
L’écologie, malgré sa proximité sémantique, ne s’en remet jamais à ce postulat.
Si l’homme souffre d’un manque voire d’une pénurie pour se maintenir en vie, l’adaptation au milieu naturel sera préférée à sa distanciation, laquelle pose la nature comme objet.
L’économie politique maquille la rareté en donnée naturelle afin de mieux justifier le déclenchement de l’activité productive des hommes.
Il en est tout autrement selon l’économiste : nous avons été chassés du paradis[4]− Propos de Lionel Robbins. / et la nature, avare de ses dons, est une dure marâtre.
C’est la raison pour laquelle l’homme doit se mettre au travail, l’exploiter et produire.
« Jusqu’à ce jour, disait Paul Samuelson, « nobélisé » en 1970, il n’existe aucun lieu du globe où l’approvisionnement en biens soit assez abondant, où les désirs des habitants assez modérés, pour que chacun puisse être plus qu’abondamment pourvu de tout ce qu’il pourrait souhaiter. »[5]− Paul Samuelson, L’Économique, Armand Colin, 1959. /
L’économie politique maquille donc la rareté en donnée naturelle afin de mieux justifier le déclenchement de l’activité productive des hommes.
La rareté a force de loi et inaugure les processus d’objectivation et d’exploitation de la nature.
Dès lors, la dure marâtre, menaçante car inhospitalière cèdera la place à la bonne nature soumise et dominée.
Pourtant, les psychanalystes nous apprennent que le travail de la terre ne répond pas exclusivement à des nécessités économiques.
Le déplacement de l’énergie humaine − sa sublimation − vers des conduites socialisées peut, par exemple dans le domaine de l’activité agricole, se traduire par une symbolisation de la fécondité.
« L’homme primitif, remarqua d’ailleurs en son temps le regretté Jean Baudrillard, dans ses échanges symboliques, ne se mesure pas avec la nature. Il ne connaît pas la Nécessité, cette loi qui ne prend effet qu’avec l’objectivation de la nature. […] La rareté n’est pas une dimension donnée de l’économie, elle est ce que produit et reproduit l’échange économique, en quoi elle s’oppose à l’échange primitif qui ne connaît rien du tout de cette « loi de la nature » dont on veut faire la dimension ontologique de l’homme. »[6]− Jean Baudrillard, Le miroir de la production ou l’illusion critique du matérialisme historique, Casterman/Poche, 1973, pp. 46-47. /
Si l’économique se borne à rechercher les moyens efficients pour lutter contre la rareté sans s’interroger sur les fins, la nature du profit, le fonctionnement de l’économie capitaliste, ses origines et ses transformations ne sont plus des objets scientifiques.
Cette stratégie de lutte contre la rareté alimente la logique de la croissance pour la croissance. Les hommes devront produire sans limite afin de combattre cette supposée rareté originelle. La croissance libère les hommes de cette pression naturelle pour leur garantir la survie.
Mais cette contrainte, une fois résolue, doit renaître pour réamorcer un nouveau cycle de production.
Tout se passe comme si l’abondance créait la rareté. Produire aveuglément conduit donc à une pénurie de ressources et à une nouvelle rareté.
La rareté détermine la rareté, elle est tout à la fois la cause et la conséquence de l’activité productive des hommes, laquelle peut ainsi croître indéfiniment.
La définition de Lionel Robbins souligne le caractère exclusivement économique de la relation entre les fins et les moyens.
Les raisons pour lesquelles les hommes produisent passent à la trappe car seule la manière de poursuivre le but recherché est analysée.
Ainsi, l’électricité s’impose aujourd’hui aux hommes et cela n’émeut pas l’économiste car la science économique n’a que faire de cette donnée exogène, étrangère à son discours.
Si l’énergie nucléaire permet de la produire à bon compte pour des consommateurs avides, pourquoi faudrait-il abandonner cette technique ?
L’implantation de puissants réacteurs est accélérée au nom d’un pragmatisme de bon aloi, quand bien même le recyclage des déchets nucléaires serait-il problématique ! Irrationnelle, la sortie du nucléaire est dès lors inenvisageable.
Ainsi que le faisait remarquer Serge Latouche : « Si l’économique se borne à rechercher les moyens efficients pour lutter contre la rareté sans s’interroger sur les fins, la nature du profit, le fonctionnement de l’économie capitaliste, ses origines et ses transformations ne sont plus des objets scientifiques. »[7]− Serge Latouche, Épistémologie et économie. Essai sur une anthropologie sociale freudo-marxiste, Anthropos, 1973, p.52. /
Peut-on encore appeler science une économie politique qui renonce à expliquer le fonctionnement des sociétés humaines ?
Raymond Barre évoquait « l’aménagement onéreux du monde » pour mieux souligner ce qui obsède les économistes : la richesse.[8]− « Tout homme qui agit s’enrichit, ou en enrichit un autre. Au contraire, tout homme qui ne fait rien s’appauvrit, ou appauvrit celui aux dépens duquel il vit. Ces deux mots, … Continue reading
Adam Smith n’a-t-il pas écrit en 1776 les fameuses « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » ?
Selon la théorie officielle, réduire la tension entre les fins et les moyens permet de produire d’abondantes richesses.
En vérité, deux voies peuvent nous mener vers l’abondance : en désirant peu ou en produisant beaucoup. Grâce à la première, nous accédons à la simplicité, la sobriété ou encore l’abondance frugale.
La seconde est la voie empruntée par nos contemporains, sous les injonctions des économistes, des marchands flanqués des publicitaires qui leur promettent une croissance du « Bonheur National Brut ».
La richesse est une notion relative au mode de vie choisi par les hommes et sa dimension matérielle n’est pas exclusive.
Les anthropologues ont clairement démenti le fait que l’accumulation de richesses était inscrite au cœur de toute société humaine.
« Il n’y a rien, dans le fonctionnement économique d’une société primitive, d’une société sans État, rien qui permette l’introduction de la différence entre plus riches et plus pauvres, car personne n’y éprouve le désir baroque de faire, posséder, paraître plus que son voisin » observa Pierre Clastres.
Avant d’ajouter, en reprenant l’idée de Marshall Sahlins : « La société primitive, première société d’abondance, ne laisse aucune place au désir de surabondance. »[9]− Pierre Clastres, La société contre l’État, Éditions de Minuit, 2011 (réédition), p. 174. /
Peut-on encore appeler science une économie politique qui renonce à expliquer le fonctionnement des sociétés humaines ?
La rareté est bel et bien une notion idéologique. Ce combat mythique mené contre elle mobilise d’insolites sujets économiques dotés, dès leur naissance, de besoins étrangement illimités.
Cette vision simpliste et naïve des économistes les prive de toute réflexion sur la généalogie des besoins humains.
De fait, le manger, le boire, le dormir servent de caution à l’émergence d’autres besoins dépourvus de toute dimension biologique, lesquels permettront néanmoins d’amorcer une production décalée voire détachée de la consommation.
En fin de compte, dans les économies entièrement subordonnées à la logique triomphante du marché, les hommes ne produisent plus ce qu’ils consomment et ne consomment plus ce qu’ils produisent, ainsi que le remarquait André Gorz.
Dès lors, il leur faudra produire sans porter un regard préalable sur ce qu’il convient de consommer, ils apprendront même à produire, au-delà du nécessaire, un superflu recherché pour ses qualités lucratives.
« Pour que l’abondance devienne une valeur, remarquait Jean Baudrillard, il faut qu’il y en ait non pas assez mais trop. »[10]− Jean Baudrillard, La société de consommation, Idées Gallimard, 1976, p. 52. /
L’institutionnalisation du gaspillage est devenue une nécessité, pour le capitalisme, car précisait-il, « c’est lui qui oriente le système. »[11]− Ibid., p. 52. /
L’illimitation des besoins humains ouvrira donc la voie de la démesure qu’empruntent désormais aveuglément les sociétés occidentales.
L’origine des besoins renvoie à l’histoire du mode de production qui les a fait naître.
L’introduction de l’automobile, dans nos sociétés de croissance, ne s’est pas faite ex nihilo.
Cette innovation, conçue par quelques aventureux capitaines d’industrie, guidés par l’audace certes mais aussi par la cupidité, a joué un rôle non négligeable dans l’évolution du capitalisme moderne.
La vision simpliste et naïve des économistes les prive de toute réflexion sur la généalogie des besoins humains.
Dans son sillage, ont jailli une multitude de besoins provoquant à leur suite tout un cortège de contraintes nouvelles, d’insatisfactions, de frustrations, de nuisances, de pollutions qu’il serait bien imprudent de sous-estimer.
Par ailleurs, au nom de l’idéal démocratique fréquemment célébré par l’élite savante et dirigeante, le mythe de l’égalité de tous les hommes devant le besoin demeure encore vivant.
Égalité virtuelle puisque seuls les besoins solvables sont reconnus. Une inégale satisfaction des besoins découle, de fait, d’une inégale répartition des revenus.
Les marxistes orthodoxes préciseraient que les rapports sociaux de production génèrent des rapports sociaux de distribution et de consommation qui leur correspondent, de sorte que, ajouteront-ils, le capitalisme produira plus de besoins qu’il ne peut en satisfaire.
La dimension anthropologique du besoin, son caractère invariant au sein de toute forme de société humaine relèvent de la mystification.
Introduire la notion de besoin dans une rhétorique désormais bien rodée, c’est en définitive, mettre à jour un outil, un ressort voire une force productive requis pour le fonctionnement d’une machine économique programmée depuis longue date au bénéfice d’une oligarchie soucieuse de maintenir sa suprématie et de faire fructifier son capital financier.
Comment prolonger l’espérance de vie du capitalisme si ce n’est en activant le levier du productivisme et celui du consumérisme ?
« Il n’y a de besoin que parce que le système en a besoin » dit encore Jean Baudrillard[12]− Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard, 1976, p. 87. / qui n’hésita nullement à parler de genèse idéologique des besoins.
LA RATIONALITÉ ÉCONOMIQUE
ET LA CROYANCE EN LA SACRO-SAINTE CROISSANCE
Sous la plume d’Adam Smith, l’homme devient prévoyant, calculateur et égoïste. Mieux ! Il est conquis par la rationalité économique.
Le comportement humain, fait de doute, d’inconstance, de passion, de fantaisie se laisse envahir par la logique de l’action rationnelle idéalement adaptée au but poursuivi.
La personne humaine douée de raison, affranchie de certaines dépendances, capable d’un discours critique, influencée en cela par la philosophie des Lumières sera aussi, et surtout, en mesure de s’adonner à des activités comptables propices à l’enrichissement.
Sans doute conviendrait-il de débattre du contenu du discours des Lumières et notamment de la religion du progrès à tout prix.
Des Lumières quelque peu tamisées seraient souhaitables car la métamorphose du citoyen éclairé en Homo Economicus, congénitalement ouvert au monde des affaires, le détournera, de toute évidence, des impératifs moraux, propres à toute forme de vie collective.
Les Chinois, convertis depuis peu au capitalisme et à sa doctrine sous-jacente, le libéralisme, réalisent aujourd’hui des taux de croissance spectaculaires grâce à des producteurs devenus, de gré ou de force, égoïstes, âpres au gain et rationnels.
Notons que Marx n’a pas su échapper au piège de la rationalité. L’auteur du Capital précise pourtant dans sa préface que l’ouvrage constitue la suite d’un écrit antérieur dont le titre était Critique de l’économie politique.
Bon nombre d’économistes produisent un discours qui ne peut plus être scientifique car il s’apparente désormais à la conviction religieuse.
Chez Marx, l’homme demeure un être actif, organisateur, conscient des conséquences de ses actes et pour qui le travail, source de toute richesse, permettra d’atteindre des objectifs conformes à la raison : « Ce n’est qu’autant que l’homme agit en propriétaire à l’égard de la nature, cette source première de tous les moyens et matériaux de travail, ce n’est que s’il la traite comme un objet lui appartenant que son travail devient la source de valeurs d’usage, partant de la richesse. »[13]− Karl Marx, Critique des programmes de Gotha et d’Erfurt, Éditions sociales, 1972, p. 23. /
L’homme accède à la joie de produire et à la jouissance du produit, développe ses propres facultés grâce à l’humanisation de la nature, laquelle autorise l’extension constante de l’activité productive.
Reconnaissant « la grande action civilisatrice du Capital », Marx partagera, sur ce point, la réflexion de ses adversaires, faisant de l’homme le maître et possesseur d’une nature condamnée à satisfaire son goût prononcé pour la recherche effrénée de gains de productivité.
Les deux systèmes productivistes que sont le capitalisme et le socialisme ne se distingueront plus que par la méthode sélectionnée : libération pleine et entière du marché pour le premier, poussée massive des forces productives au service du prolétariat pour le second.
Le dispositif rareté-besoins-richesses-rationalité fabrique en définitive une économie centrée sur un acteur économique profondément égoïste, poursuivant son seul intérêt en vue de maximiser sa fonction d’utilité, pour reprendre le jargon des économistes néo-classiques.
Le bien-être collectif, la richesse sociale seront la résultante des satisfactions individuelles.
Dans ce cadre théorique, nous l’avons déjà souligné, la croissance libère l’homme de la pression naturelle mais d’une manière telle que cette libération doit renaître en toutes circonstances afin de pérenniser le mécanisme de la croissance. En somme, l’homme ne peut pas, ne doit pas être libéré de son libérateur.[14]− Remarque pertinente faite par Guy Debord dans La société du spectacle, p. 25. /
Empruntée à l’univers biologique, la croissance devenue économique fonctionne comme une métaphore et revêt la forme du mythe.
Bon nombre d’économistes, mais aussi les hommes d’affaires, les financiers, beaucoup d’élus politiques, une poignée de journalistes complices et influents sont passés de la déraison à la croyance en célébrant quotidiennement le culte de la croissance et, ce faisant, ils produisent un discours qui ne peut plus être scientifique car il s’apparente désormais à la conviction religieuse.
Ils vénèrent, tous unanimement, la Sainte croissance et estiment ne pas devoir se justifier sur le bien-fondé de leur croyance.
Empruntée à l’univers biologique, la croissance devenue économique fonctionne comme une métaphore. Apparentée à l’idéologie dominante de nos sociétés, elle revêt la forme du mythe.
La croissance économique est ce qui va de soi, est ce qui va sans dire. Elle dispose ainsi d’emblée, d’une dimension sacrée qui la met, en principe, à l’abri de toute remise en cause, de toute insulte.
Les experts croient toujours en la croissance avec conviction, avec frénésie, sans être jamais ébranlés dans leur croyance, par le doute le plus léger. D’ailleurs, ils y croient tellement qu’ils ne croient plus qu’ils y croient !
Ainsi, ils en viennent à fabriquer de toutes pièces, en manipulant l’opinion publique, une croyance partagée dont la diffusion constitue l’une de leurs missions préférées. Ils veulent convertir au plus vite les derniers mécréants.
A dire vrai, les fidèles serviteurs du dogme de la croissance espèrent cacher soigneusement, derrière un discours démagogique destiné à étendre leur influence et conforter leur pouvoir, le motif inavouable de leur croyance.
Ils avancent masqués, réclament la croissance, sachant parfaitement que celle-ci, loin de satisfaire les appétits de tous, apportera en réalité une jouissance matérielle grandissante à quelques uns.
S’interroger sur la robustesse de cette croyance et se prononcer pour une objection de croissance deviennent, aujourd’hui, des entreprises de salubrité publique.
Le discours de l’économie politique est né avec la révolution industrielle et lui a apporté la caution théorique et scientifique indispensable.
Ausculter le moteur de la croissance capitaliste, analyser sa structure, le démonter pièce par pièce et mettre en évidence la logique de l’accumulation du capital avec pour levier unique la recherche inlassable du profit, cet immense travail intellectuel de démystification entrepris par Marx est digne de l’estime que lui reconnaîtront, en l’occurrence, l’ensemble des objecteurs de croissance.
Car en définitive, la croissance économique, c’est la croissance du capital et du capitalisme. « Si le prolétaire n’est qu’une machine à produire de la plus-value, le capitaliste n’est qu’une machine à capitaliser cette plus-value. » dira-t-il.[15]− Karl Marx, Le Capital, Livre I, Éditions Garnier Flammarion, 1969, p. 430. /
Le capital ne meurt jamais, sa vocation est de croître indéfiniment et pour parvenir à ses fins, peu importe le contenu de la croissance.
Le discours de l’économie politique est devenu une nécessité vers le milieu du XVIIIème siècle, c’est-à-dire à une période déterminée et déterminante de l’histoire des sociétés occidentales.
Il est né avec la révolution industrielle et lui a apporté la caution théorique et scientifique indispensable.
Dès 1776, Adam Smith affirme que le comportement économique de l’homme repose sur des lois naturelles. La main invisible − concept-clé du libéralisme − contribue également à naturaliser le marché.
A l’aide d’une interprétation erronée du passé de l’humanité, l’homme primitif et l’homme moderne se voient ainsi dotés des mêmes intentions : la propension à l’échange, la recherche d’avantages matériels, l’appât du gain − stimulant d’un travail aliéné et divisé —, l’obligation de se mesurer avec la nature, le besoin d’accumuler des richesses et de dégager un surplus, le comportement rationnel visant à acquérir des biens rares.
La science économique n’intègre pas les apports essentiels de disciplines comme l’anthropologie, l’ethnologie, la sociologie ou la psychanalyse.
Karl Polanyi fustigea cette analyse en déclarant : « En fait, les idées d’Adam Smith sur la psychologie économique du premier homme étaient aussi fausses que celles de Rousseau sur la psychologie politique du sauvage. […] La prétendue tendance de l’homme au troc et à l’échange est presque entièrement apocryphe. »[16]− Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 2008, p. 72. /
La science économique n’intègre pas les apports essentiels de disciplines comme l’anthropologie, l’ethnologie, la sociologie ou la psychanalyse. Certes, elles étaient logiquement ignorées de Ricardo, Smith ou Marx mais leurs héritiers sont, sur ce plan, impardonnables.[17]− John Maynard Keynes, reconnaissons-le, inspiré par les écrits de Sigmund Freud, avait vu dans l’amour de la monnaie un état morbide plutôt répugnant. /
A y regarder de plus près, si les économistes sont réfractaires au message trop subversif des ethnologues, des sociologues et des psychanalystes, c’est parce que ceux-ci, avait remarqué Serge Latouche, « ont rencontré sans la chercher une économie politique qui n’était pas celle des économistes. »[18]− Serge Latouche, Épistémologie et économie, p. 33. /
Dans les traités d’économie politique, l’homme n’est qu’un producteur, un outil de travail, un facteur de production, un capital humain dont le labeur est source de richesses convoitées par tous.
Rien ne sera dit de la pénibilité du travail, de la souffrance physique et psychologique qu’il génère, du chantage exercé trop souvent par les directions des ressources humaines sur les salariés les plus vulnérables lorsque le chômage menace, rien de la subordination du travailleur au fétichisme de la marchandise[19]− A l’exception notoire de Marx, bien entendu ! / et de l’argent.
Bien entendu, on s’abstiendra d’y évoquer l’importance des liens unissant les hommes durant l’acte de production comme s’il fallait mieux oublier les classes laborieuses longtemps perçues comme dangereuses !
Quant à l’écologie sociale, à l’écologie politique, elles sont superbement ignorées, pour ne pas dire méprisées par la science économique.
Certes, nous précisera-t-on, la croissance verte, la croissance écologique, le développement durable ou encore la recherche en géo-ingénierie sont désormais introduits dans quelques analyses économiques.
Ce sont autant d’oxymores ou de fausses solutions retenus par effet de mode, destinés à maintenir le même imaginaire : produire aveuglément des biens et des services présumés plus « propres » afin de répondre aux besoins croissants d’une population croissante et prétendument exigeante, de créer des emplois dont on se moque bien de savoir s’ils échappent à la précarité et si leur utilité sociale est avérée.
Avec le capitalisme, la sphère économique est dramatiquement devenue autonome en se détachant de son enveloppe culturelle et de ses racines naturelles.
La sortie indispensable du discours dominant de la science économique paraîtra à l’évidence iconoclaste à ceux qui préfèrent les mensonges qui rassurent aux vérités qui inquiètent.
Aucune société humaine ne saurait vivre sans organiser, même succinctement, une production matérielle.
Les sociétés primitives, les peuples de chasseurs-cueilleurs non sédentarisés consacraient quelques heures de leur quotidien à ce que nous pourrions appeler, par commodité, une activité productive, avant de dégager un peu plus de temps pour l’entretien des liens communautaires.
Pour autant, ces groupes d’hommes, n’exprimaient pas le désir de se laisser envahir par le travail et la production superflue ni d’introduire une concurrence acharnée au sein des relations sociales.
« Qu’est-ce qui fait que dans une société primitive l’économie n’est pas politique ? s’interrogeait Pierre Clastres. Cela tient, on le voit, à ce que l’économie n’y fonctionne pas de manière autonome. On pourrait dire, ajoutait-il, qu’en ce sens les sociétés primitives sont des sociétés sans économie par refus de l’économie. »[20]− Pierre Clastres, La société contre l’État, p. 170. /
La sortie indispensable du discours dominant de la science économique paraîtra à l’évidence iconoclaste à ceux qui préfèrent les mensonges qui rassurent aux vérités qui inquiètent.
Toutefois, il est urgent d’imposer à l’économie la finitude de la planète et de permettre à l’écologie de l’orienter pour mieux l’absorber. De même, ainsi que le suggéra Karl Polanyi, il faudra ré-encastrer l’économie dans les relations sociales.
En conséquence, la subordination de l’activité économique aux impératifs écologiques et sociaux ne sera accomplie que si nous parvenons à nous débarrasser, une fois pour toutes, de l’imaginaire productiviste occidental et du culte de la croissance inscrits, de longue date, au sein du discours idéologique totalitaire de la science économique.
Didier Harpagès
*Parce que les écrits, même sur Internet, ne restent pas toujours, nous avons entrepris en 2024 de republier 30 des textes (tribunes libres, « Grands Entretiens », reportages, enquêtes…) que nous avons mis en ligne depuis février 2015. Cette tribune libre a été publiée pour la première fois le 18 mai 2015.
* * *
Notes[+]
| ↑1 | − Guy Debord, La société du spectacle, Champ Libre, 1976, p. 25. / |
|---|---|
| ↑2 | − Céline Pessis, Sezin Topçu et Christophe Bonneuil, Une autre histoire des « Trente Glorieuses ». Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre, La Découverte, 2013. / |
| ↑3 | − Lionel Robbins, Essai sur la nature et la signification de la science économique, Médicis, 1947, p. 29. Les collectionneurs seront peut-être intéressés par la définition de Raymond Barre, la référence en économie durant les années 1960 : « L’économie est la science de l’administration des ressources rares dans une société humaine : elle étudie les formes que prennent les comportements humains et les conduites sociales dans l’aménagement onéreux du monde extérieur et les actes qui se proposent de réduire la tension qui existe entre les désirs illimités et les moyens limités des sujets économiques », Raymond Barre, Économie politique, Presses Universitaires de France, 1961, tome 1, p. 12. / |
| ↑4 | − Propos de Lionel Robbins. / |
| ↑5 | − Paul Samuelson, L’Économique, Armand Colin, 1959. / |
| ↑6 | − Jean Baudrillard, Le miroir de la production ou l’illusion critique du matérialisme historique, Casterman/Poche, 1973, pp. 46-47. / |
| ↑7 | − Serge Latouche, Épistémologie et économie. Essai sur une anthropologie sociale freudo-marxiste, Anthropos, 1973, p.52. / |
| ↑8 | − « Tout homme qui agit s’enrichit, ou en enrichit un autre. Au contraire, tout homme qui ne fait rien s’appauvrit, ou appauvrit celui aux dépens duquel il vit. Ces deux mots, laisser-faire et laisser-passer, étant deux sources continuelles d’actions, seraient donc pour nous deux sources continuelles de richesses », Vincent de Gournay (1753), cité par Claude Lléna dans Lao-Tseu et les taoïstes ou la recherche d’une vie harmonieuse, Le Passager clandestin, 2014, p. 37. / |
| ↑9 | − Pierre Clastres, La société contre l’État, Éditions de Minuit, 2011 (réédition), p. 174. / |
| ↑10 | − Jean Baudrillard, La société de consommation, Idées Gallimard, 1976, p. 52. / |
| ↑11 | − Ibid., p. 52. / |
| ↑12 | − Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard, 1976, p. 87. / |
| ↑13 | − Karl Marx, Critique des programmes de Gotha et d’Erfurt, Éditions sociales, 1972, p. 23. / |
| ↑14 | − Remarque pertinente faite par Guy Debord dans La société du spectacle, p. 25. / |
| ↑15 | − Karl Marx, Le Capital, Livre I, Éditions Garnier Flammarion, 1969, p. 430. / |
| ↑16 | − Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, 2008, p. 72. / |
| ↑17 | − John Maynard Keynes, reconnaissons-le, inspiré par les écrits de Sigmund Freud, avait vu dans l’amour de la monnaie un état morbide plutôt répugnant. / |
| ↑18 | − Serge Latouche, Épistémologie et économie, p. 33. / |
| ↑19 | − A l’exception notoire de Marx, bien entendu ! / |
| ↑20 | − Pierre Clastres, La société contre l’État, p. 170. / |



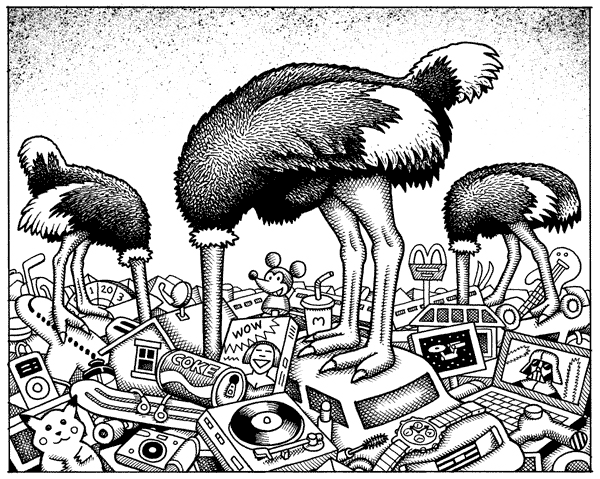
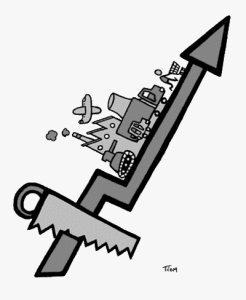







3 réponses
Après la forme, le fond:
Quand je suis né ( 1955), nous n’étions pas 3 milliards.
Maintenant, nous sommes 8 milliards. J’aimerai que ce Monsieur m’explique comment, sans croissance continue, l’humanité aurait pu subvenir à ses besoins?
Autre question: le principe de l’offre et de la demande est-il un principe issu du capitalisme et propre à lui, ou n’est-il pas un principe aussi fondamental que celui de la gravitation universelle en physique, et qu’on ne peut donc escamoter. Quand on veut l’escamoter comme semble le vouloir l’auteur, ne revient-il pas au galop, quelle que soit la politique économique pratiquée, qu’elle soit libérale, socialiste, capitaliste, marxiste, maoïste, trotskiste, ou autres?
Pour moi, la réponse est claire.
Peut-être que vous ne savez pas exactement ce qu’est la « croissance économique ». Il vaudrait la peine d’approfondir.
Ensuite, le « principe » de l’offre et de la demande a, comme vous le mentionnez, un force naturelle derrière lui. Mais en économie, on parle de « loi de l’offre et de la demande » et c’est tout autre chose : un modèle qui a zéro correspondance concrète dans le monde, un modèle théorique, utile parfois, mais qui ne correspond effectivement pas à la réalité.
Si l’économie s’apprenait au comptoir, cela se saurait. 🙂
Il existe un phénomène naturel, dont dépendent la survie et le confort de l’espèce, qu’on appelle « économie » et qui est justiciable de l’investigation scientifique. Il existe des politiques économiques qui, elles, sont normatives et relèvent donc de l’éthique. Mais « l’Économie politique » est une construction fantasmatique.
En dépit de toutes les cririques qu’ leur sont adressées, les économistes continuent de truster l’information et l’université. A quelques mois de ma retraite, je me suis inscrit en préparation de thèse à Marne-la-Vallée. Ayant découvert et démontré que le PIB est redondant pour une raison purement idéologique, j’ai été interdit de soutenance. Cherchant à faire connaître mes recherches par l’intermédiaire de l’édition, je suis tombé sur le mur des lecteurs économistes. Si Kafka était encore de ce monde, il y trouverait le thème d’un nouveau Château.